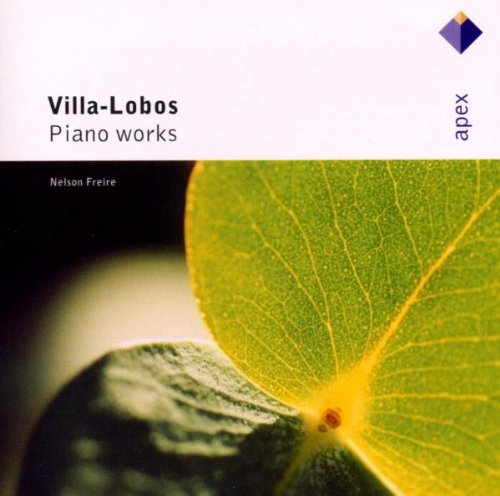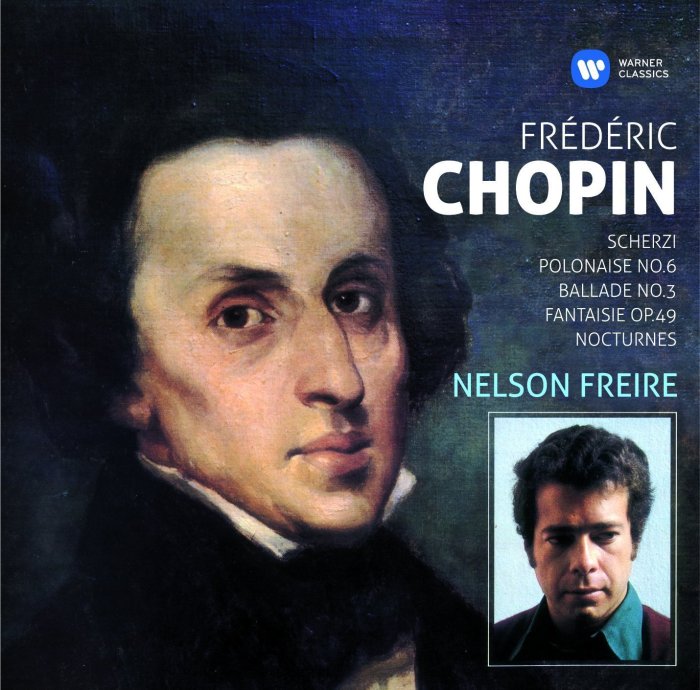Je l’avais annoncé dans mon billet Festival d’orchestres, mais, anniversaires obligent (Orchestre de Paris, Barenboim 75), j’ai différé de quelques jours l’hommage que je veux rendre à un chef sur qui j’ai eu des avis contrastés, Georges Prêtre (lire Série noire).
En effet, Sony/RCA sort un coffret annoncé, à tort, comme comprenant l’intégrale des enregistrements du chef français sous étiquette RCA.


Il manque à ce coffret une formidable version de la Symphonie en ut de Bizet, captée à Bamberg.

Mais pour le reste, à côté de deux opéras souvent réédités – pour moi l’une des plus belles versions de Traviata avec la jeune Montserrat Caballé, et une Lucia di Lammermoor vénéneuse avec Anna Moffo – d’authentiques découvertes.
J’ignorais que Georges Prêtre eût enregistré des symphonies de Sibelius – le moins qu’on puisse dire c’est qu’il est très à l’aise et convaincant dans un univers sonore très éloigné de son coeur de répertoire, aussi bien dans la 2ème que la 5ème symphonie et dans un poème symphonique qui a résisté à plus d’une baguette Chevauchée nocturne et Lever de soleil.
A écouter Also sprach Zarathustra, on regrette que Prêtre – qui a dirigé la création française de Capriccio à l’Opéra de Paris en 1964 avec Elisabeth Schwarzkopf – n’ait pas enregistré plus de Richard Strauss. Relever aussi un magnifique 3ème concerto de Rachmaninov par un Alexis Weissenberg à son meilleur – en 1967 – bien préférable à la version ultérieure avec Bernstein et l’Orchestre national. Et un récital plus anecdotique de la grande Shirley Verrett. L’occasion aussi de retrouver un grand violoniste italien un peu négligé chez nous, Uto Ughi, dans Bruch et Mendelssohn.
Mais il était impensable de ne pas retrouver Georges Prêtre dans de la musique française (malgré l’oubli du CD Bizet). Un doublé Berlioz, Harold en Italie et la Symphonie fantastique captés à Boston, sur les traces de Charles Munch.
Un coffret qui rend mieux justice à l’art polymorphe du chef décédé au début de cette année, et qui complète celui, plus fourre-tout, que Warner lui avait consacré: Georges Prêtre 1924-2017








 (Photo Eric Dahan)
(Photo Eric Dahan)
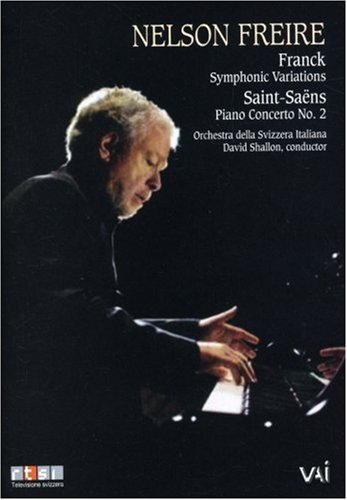



 Dans le dernier numéro de Gramophone le pianiste est évoqué, par euphémisme, comme « peu soucieux de couleurs ». Qu’en termes élégants ces choses-là sont dites.. Virtuose certes, chez lui dans Rachmaninov ou Prokofiev, avare de poésie et de fantaisie dans le répertoire romantique (Beethoven, Brahms, Schumann, Chopin), je n’ai jamais accroché à Ashkenazy pianiste, surtout lorsqu’il est enregistré dans des acoustiques de salle de bain ou sur des pianos ferraillants qui durcissent un jeu qui n’est déjà pas très varié. J’ai toujours trouvé mieux, plus intéressant, plus idiomatique ailleurs.
Dans le dernier numéro de Gramophone le pianiste est évoqué, par euphémisme, comme « peu soucieux de couleurs ». Qu’en termes élégants ces choses-là sont dites.. Virtuose certes, chez lui dans Rachmaninov ou Prokofiev, avare de poésie et de fantaisie dans le répertoire romantique (Beethoven, Brahms, Schumann, Chopin), je n’ai jamais accroché à Ashkenazy pianiste, surtout lorsqu’il est enregistré dans des acoustiques de salle de bain ou sur des pianos ferraillants qui durcissent un jeu qui n’est déjà pas très varié. J’ai toujours trouvé mieux, plus intéressant, plus idiomatique ailleurs.