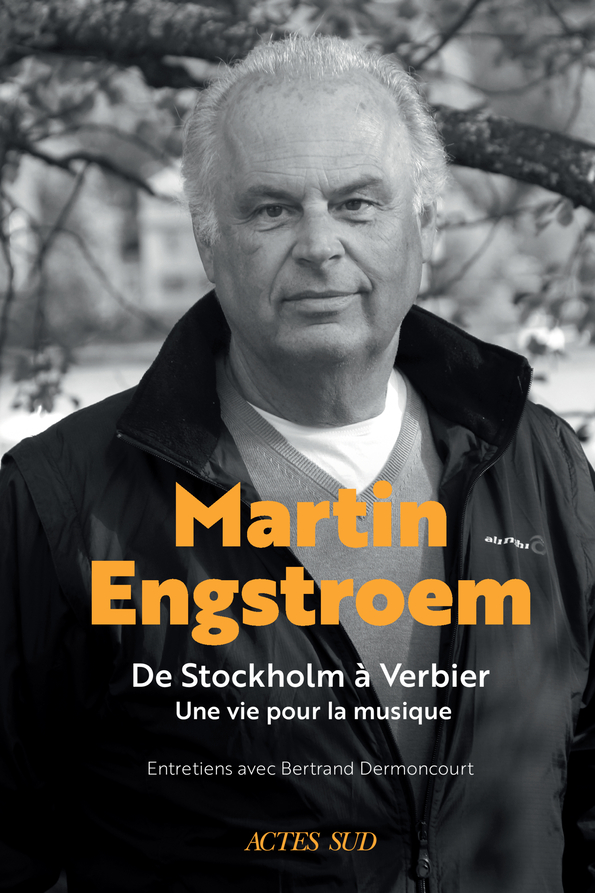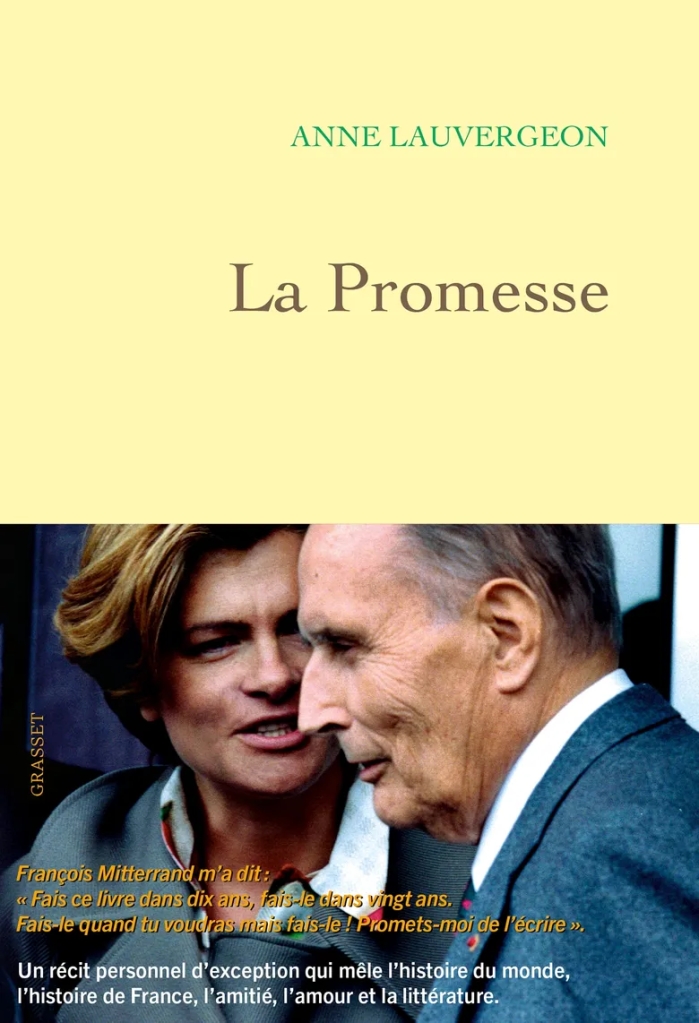Bernard Pivot (1935-2024)
Tout le monde a rendu ou va rendre hommage à Bernard Pivot et ce n’est que justice.

J’ai moi-même raconté sur Facebook mon seul souvenir d’une rencontre avec lui :
« J’ai un seul souvenir, minuscule, d’un contact direct avec Bernard Pivot. Il y a une quinzaine d’années, je fréquentais le Balzar, à côté de la Sorbonne, à l’époque où l’on pouvait encore y manger convenablement. Il y avait des habitués, célèbres ou moins. Un jour on m’assied à côté de la table de Jean Tulard (qui se plaçait toujours face au miroir de dos à la salle). A peine étais-je installé que je vois s’approcher Bernard Pivot, qui prend place à ma droite. Inévitablement j’entends la conversation entre Pivot et Tulard et un troisième convive que je n’ai pas identifié. Je vois que Pivot regarde souvent en ma direction. Apercevant Le Monde du jour sur un coin de ma table, il en prend prétexte pour me demander où j’ai pu me procurer le journal normalement pas disponible en kiosque avant 14 h. C’est ainsi que nous avons échangé de délicieuses banalités et que j’ai eu l’impression que mon illustre voisin aurait bien aimé poursuivre la conversation avec l’inconnu que j’étais, plutôt qu’avec ses commensaux. J’eus aussi à ce moment-là la confirmation de l’influence du « Roi Lire » sur le monde des lettres, lorsque deux autres hôtes du Balzar s’en vinrent le saluer respectueusement : Jean-Noël Jeanneney et l’académicien Marc Fumaroli, tout en remerciements d’un article qu’avait dû lui consacrer Pivot.
La dernière apparition de Bernard Pivot à la télévision – dans C à vous je crois – m’avait profondément attristé. D’une absolue lucidité sur son état – ces mots qui désormais lui manquaient, s’absentaient – je m’étais dit que ce soir-là il prenait congé de nous. »
Mais on pourra voir et revoir bien sûr ses grandes émissions et ses interviews mythiques avec les plus grands auteurs du XXe siècle. Et surtout si l’on veut retrouver ce personnage si profondément sympathique, relire cette manière d’autobiographie

« Mots autobiographiques, mots intimes, mots professionnels, mots littéraires, mots gourmands… Tous ces mots forment un dictionnaire très personnel. Mais les mots de ma vie, c’est aussi ma vie avec les mots. J’ai aimé les mots avant de lire des romans. J’ai vagabondé dans le vocabulaire avant de me promener dans la littérature » (Bernard Pivot)
La Neuvième a 200 ans
Renaud Machart nous rappelle opportunément dans Le Monde que la Neuvième symphonie de Beethoven a été créée le 7 mai 1824 : ‘Il allait de soi qu’Arte, chaîne franco-allemande, fasse honneur à la Symphonie no 9 de Ludwig van Beethoven (1770-1827), créée voici deux siècles exactement, le 7 mai 1824 : le compositeur allemand avait cru dans les promesses des Lumières et de la Révolution française avant de devenir – par-delà le bien et le mal – un symbole national allemand puis européen. » A suivre donc ce soir sur Arte et sur Arte.tv une soirée exceptionnelle.
La charge symbolique et politique de l’ultime symphonie de Beethoven reste puissante. On se rappelle tous ce concert extraordinaire au lendemain de la chute du Mur de Berlin, et les choeurs rassemblés sous la houlette de Leonard Bernstein transformant le texte de Schiller en « Ode à la Liberté«