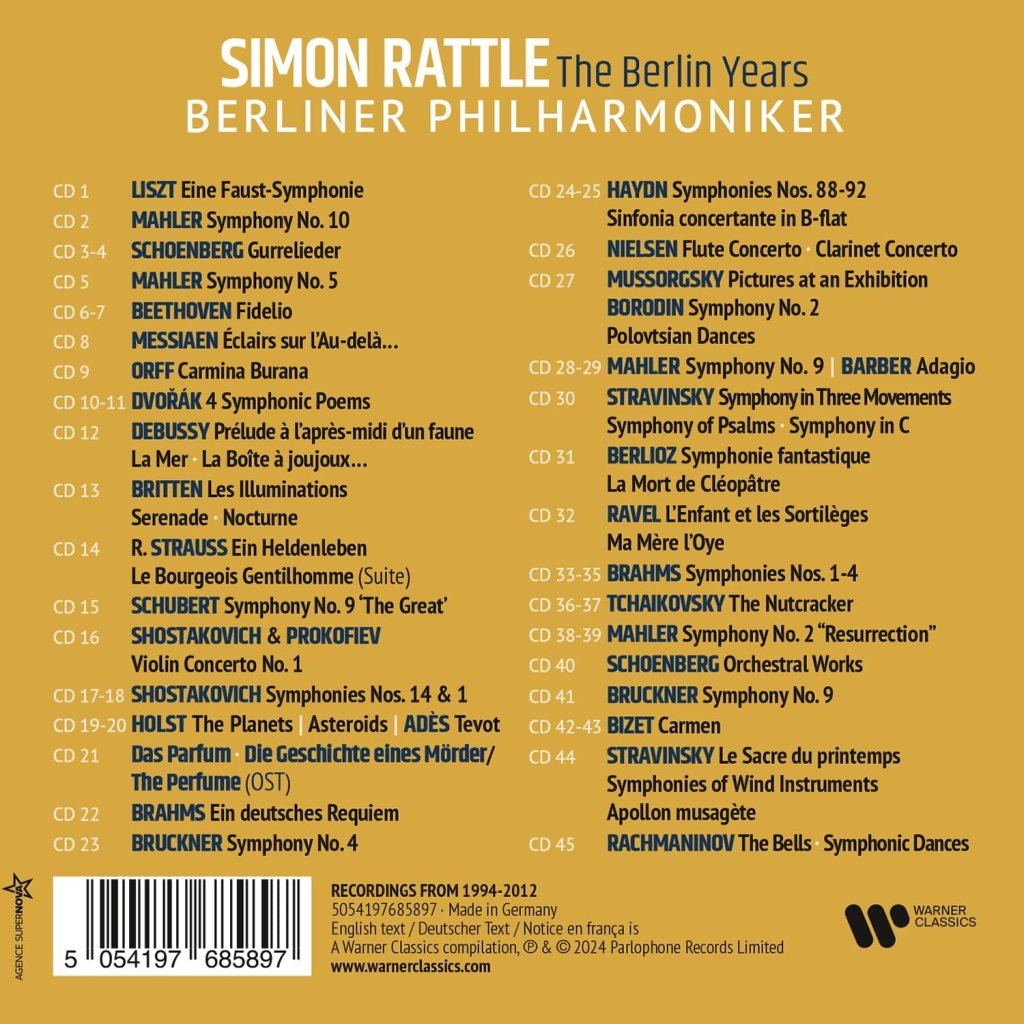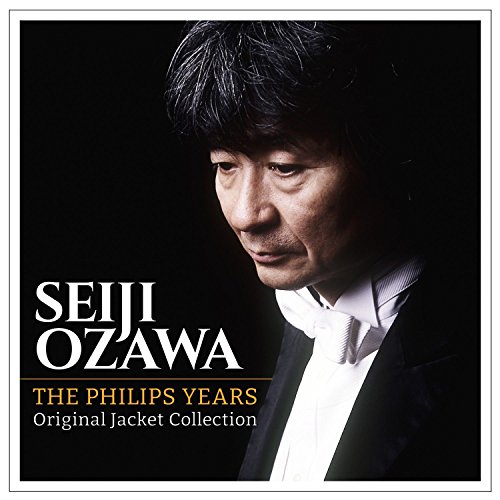C’est à croire que toute la touristerie s’est donné rendez-vous sur la côte basque coté français durant ce viaduc de l’Ascension. Biarritz inatteignable, Guéthary invisitable, et finalement non sans bouchons, l’accès à un nouveau parking de Saint-Jean de Luz peu avant qu’il affiche complet. Mais en sortant, la récompense : la vue directe sur la maison natale de Ravel de l’autre côté du port sur la commune de Ciboure (l’étrange façade flamande qui détonne au milieu des maisons en pur style basque.

En rentrant je me replongerai dans les écrits de Ravel. Où il évoque sa « basquitude », ses fréquents retours au pays. J’ai trouvé ceci, un témoignage de Gustave Samazeuilh sur « les nombreux étés que nous avons passés ensemble en ce Pays Basque… Nous voisinions quotidiennement, soit dans les logis qu’il habita successivement à Ciboure ou dans la grande rue de Saint-Jean-de-Luz, soit sur ce coteau de Bordagain, où les miens et moi-même avions fixé nos pénates. Ravel aimait le vaste horizon de mer et de montagne qu’on y découvre. Il goûtait la douceur de l’air, la lumière affectueuse et vive. Que de fois sommes-nous montés en haut de la tour de l’ancienne abbaye de Bordagain pour voir se coucher le soleil ou monter la lune au zénith, quitte à prolonger ensuite notre soirée en la maison voisine aux volets rouges, dont l’isolement nous permettait de musiquer ou de deviser jusqu’à des heures fort avancées ? En descendant vers Saint-Jean-de-Luz le matin, je passais devant la maison de Ravel. Un siffle de ralliement bien connu de ses amis d’alors : le thème initial de la Seconde Symphonie de Borodine… Ravel se mettait à sa fenêtre, souvent en pittoresque costume de bain.
D’autres fois, j’entendais son piano, je grimpais ses étages, et j’avais souvent de précieuses surprises. Une autre fois – beaucoup plus tard – je goûtais le savoureux spectacle de voir Ravel en peignoir jaune et en bonnet rouge écarlate, me jouant d’un doigt, avant d’aller prendre notre bain matinal, le thème du Boléro, et me disant : « Mme Rubinstein me demande un ballet. Ne trouvez-vous pas que ce thème a de l’insistance ? Je m’en vais essayer de le redire un bon nombre de fois sans aucun développement en graduant de mon mieux mon orchestre. » On sait avec quelle étourdissante virtuosité il sut réussir cette gageure.
D’autres jours, nous allions faire de longues promenades pédestres ou des randonnées automobiles en Béarn, sur la côte espagnole jusqu’à Santander, en Navarre, en Soule. Je me souviens, en particulier, de celle qui nous amena, par l’admirable route du col de Lesaca, de Pampelune à Estella, et retour par Roncevaux, Saint-Jean-Pied-de-Port et Mauléon. Ravel en avait rapporté le plan d’une œuvre basque pour piano et orchestre, « Saspiak bat », dont il m’a souvent parlé, et que seule la difficulté qu’il éprouva à trouver l’idée pour la pièce expressive du milieu, à laquelle il tenait particulièrement, lui fit abandonner. J’ai toujours pensé que les éléments des pièces vives, notamment de la première et la dernière : une fête sur la place de Mauléon, avaient été utilisées dans les pièces correspondantes du Premier Concerto de piano… »
Saint-Jean-de-Luz et Louis XIV
Saint-Jean-de-Luz est entrée dans la grande histoire de France pour avoir hébergé le mariage de Louis XIV avec l’infante d’Espagne, Marie-Thérèse d’Autriche le 9 juin 1660 en l’église Saint-Jean-Baptiste.




L’attrait principal de Saint-Jean-de-Luz est bien entendu son bord de mer, qui n’est pas, comme d’autres de la côte basque, envahi par les terrasses et les échoppes.

Ce que j’ai découvert, en longeant l’élégant bâtiment de La Pergola, qui abrite le Casino, c’est que c’est l’oeuvre de l’architecte Robert Mallet-Stevens en 1927

Saint-Jean-Pied-de-Port et les pèlerins de Compostelle
Sans le savoir, j’ai emprunté les routes qu’aimait parcourir Ravel avec son ami Samazeuilh, dans ce pays basque pyrénéen si charmant. Ainsi cette halte à Saint-Jean-Pied-de-Port, où l’on a vu nombre de pèlerins en chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle.




On aurait pu emprunter le col de Roncevaux, se remémorer la Chanson de Roland, mais une manifestation apparemment sportive nous a privé de cet itinéraire. Pour s’en consoler, on peut écouter cet air extrait d’un opéra dont j’ignorais même jusqu’à l’existence avant que le Palazzetto Bru Zane ne l’exhume – Roland à Roncevaux – d’Auguste Mermet, un ouvrage de 1864.