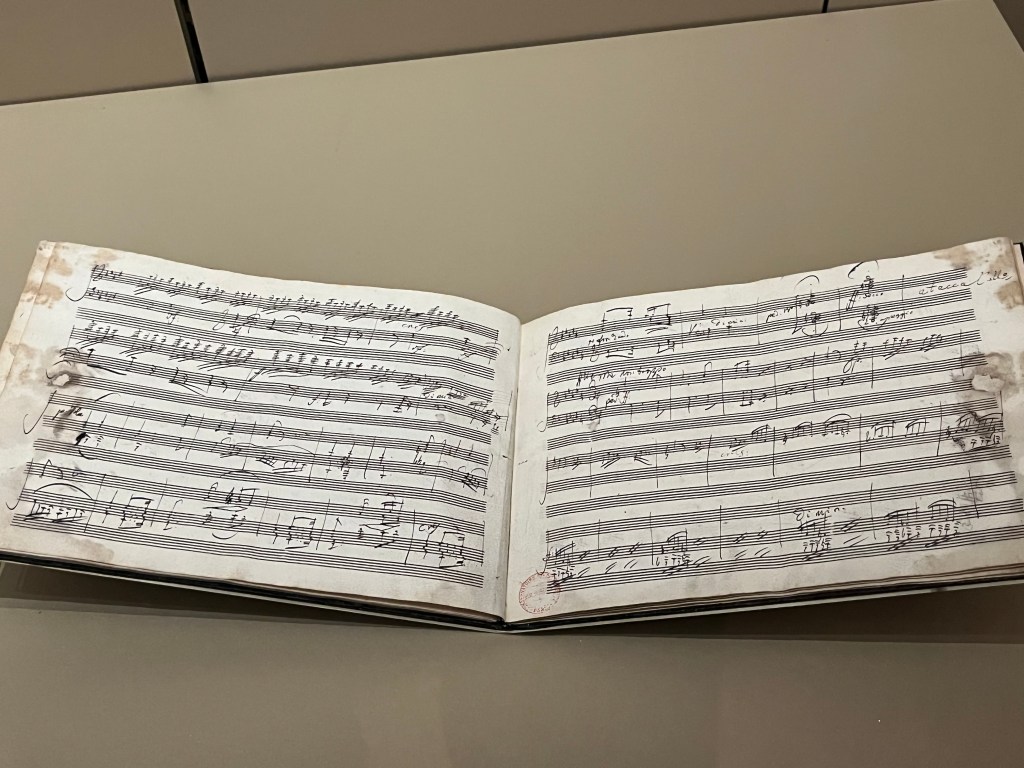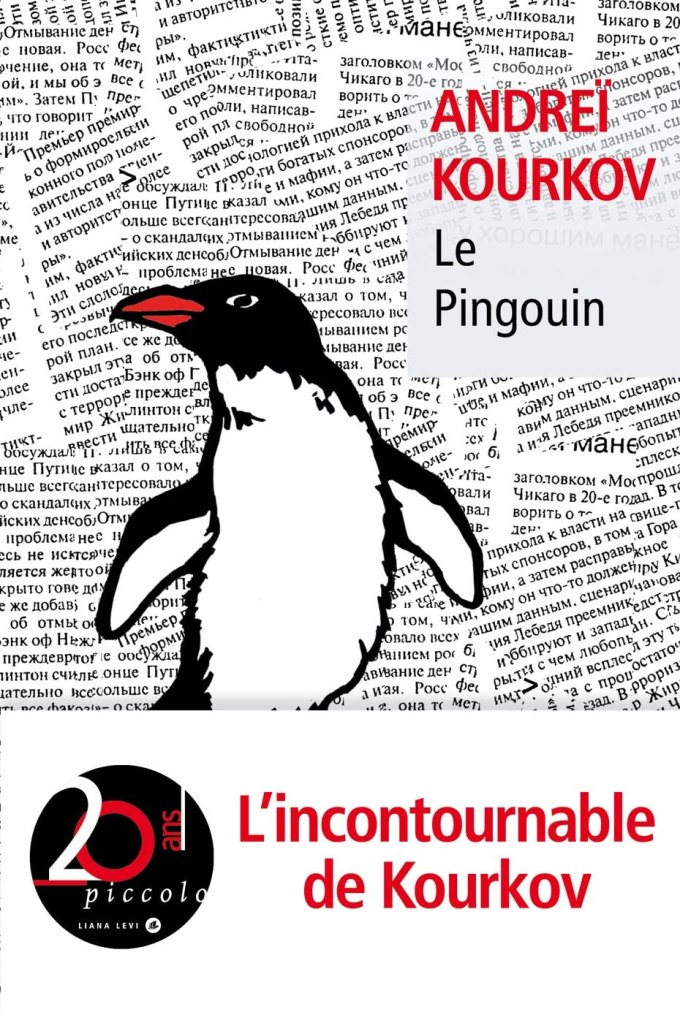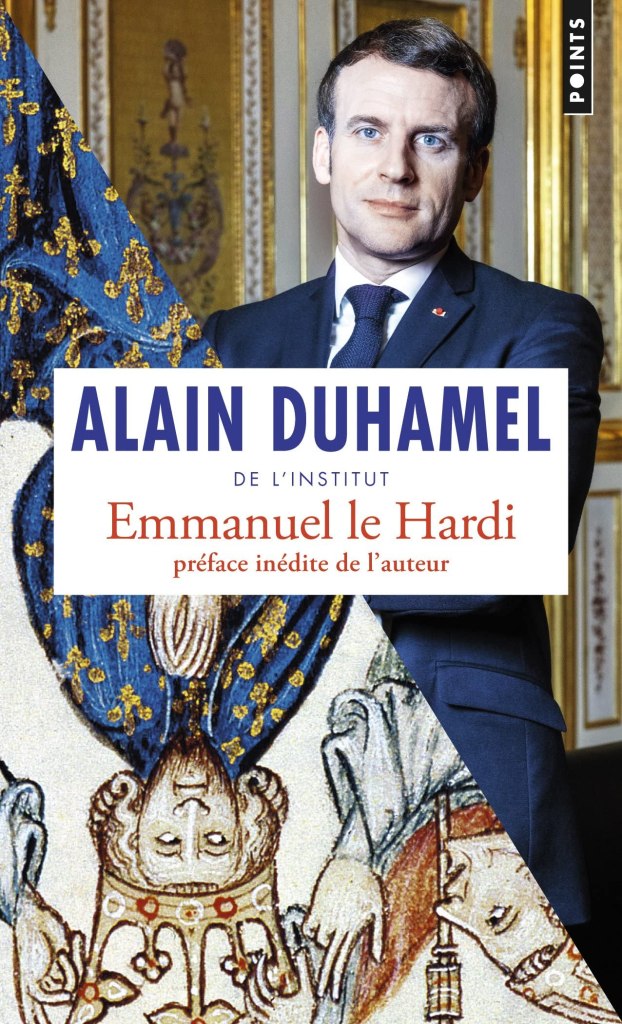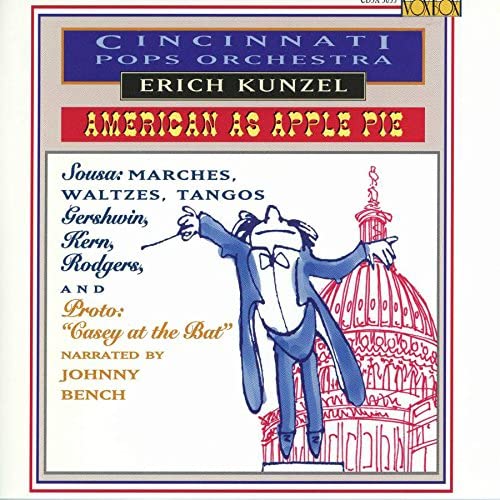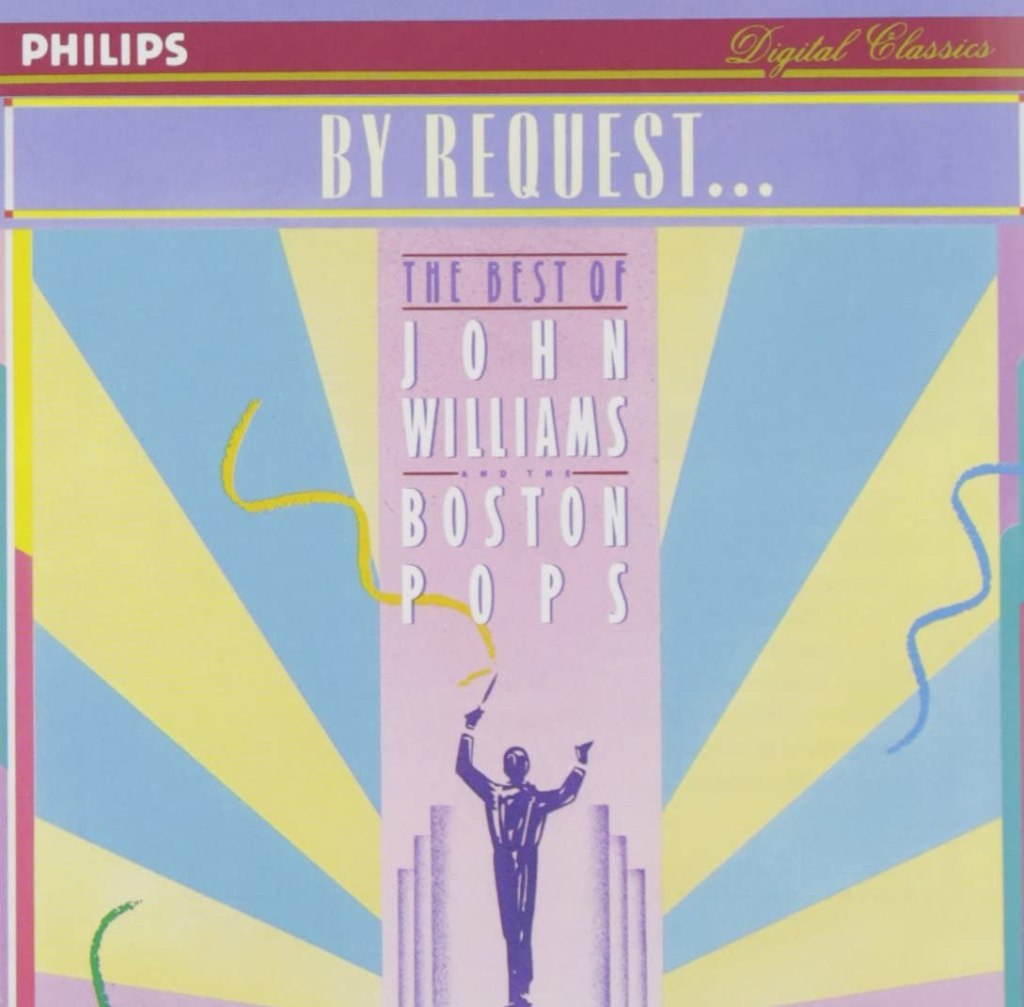Après trois semaines au Kirghizistan d’abord, en Ouzbékistan ensuite, on ne peut pas dire qu’on connaît les pays qu’on a traversés ni les gens qu’on a croisés.


Mais on a noté quelques petites choses, amusantes ou sérieuses, qui éclairent, parfois contredisent l’idée qu’on se fait de ces contrées fascinantes quand on les imagine de loin.
Les femmes sans voile
Elles paraissent bien dérisoires, stupides même, les polémiques que certains nourrissent à dessein en France sur la tenue des femmes musulmanes, le voile, l’abaya etc.
Dans les deux pays, l’islam est la religion dominante. Toutes les femmes, à commencer par nos guides au Kirghizistan comme à Tachkent ou Khiva, que nous avons rencontrées, sont musulmanes. Aucune ne porte un foulard ou un voile, sauf les plus âgées quand elles sortent en ville avec leurs plus belles robes. On a aperçu quelques jeunes filles voilées. C’est une mode « ridicule » nous ont dit nos guides, jeunes femmes – l’une d’elles se marie dans trois semaines – nous expliquant que le voile intégral n’était porté que par les femmes arabes dans le désert pour se protéger du soleil et du sable. Mais qu’ici en Asie centrale, dès les années 1920, partout elles se sont émancipées du port du foulard ou du voile.

Depuis mon retour, on a appris ces nouvelles décisions des talibans au pouvoir dans le pays voisin de l’Ouzbékistan, l’Afghanistan : Les talibans interdisent aux Afghanes de chanter, de lire en public et de se déplacer seules.
Les traditions de famille
En revanche, dans les deux pays, la jeune génération n’entend s’affranchir d’aucune tradition familiale, aussi surprenante ou pesante qu’elle nous semble. A ce sujet, une observation : quel que soit le pays que je visite, je fais toujours abstraction, j’essaie en tout cas, de mes références culturelles ou sociologiques, je regarde, j’observe, j’écoute, je dialogue si possible, et je ne porte pas de jugement de valeur.
Le mariage est la cérémonie la plus importante. La jeune fille, qui doit y arriver vierge, s’y prépare avec sa famille des mois durant. Il convient de préparer le trousseau (ou la dot !) avant de partir vivre dans la famille du mari et de servir ses beaux-parents. Le fils aîné a charge de veiller sur ses parents jusqu’à leur mort.
La célébration du mariage rassemble plusieurs centaines d’invités (et coûte une petite fortune!) mais il n’est pas question de la jouer petit bras.
Il en est de même pour la fête de la circoncision – qui se pratique en général à l’âge de 2-3 ans. Dans plusieurs villes ouzbeks nous avons assisté à d’impressionnants cortèges.

La Russie, les Russes et le russe
Visitant deux anciennes républiques soviétiques, devenues indépendantes à la chute de l’URSS en 1991, on ne peut évidemment ignorer l’impact de plus de six décennies de pouvoir communiste. Il y a des similitudes entre Kirghizistan et Ouzbékistan, notamment quant à la période tsariste


mais il y a surtout beaucoup de contrastes qui frappent dès l’arrivée dans l’un et l’autre pays.
Au Kirghizistan, tous les panneaux sont écrits en cyrillique, dans les deux langues officielles du pays, le russe et le kirghiz. Voir mon album photos sur la capitale Bichkek, une ville soviétique en Asie centrale. Les statues de Lénine ne sont pas rares dans le pays. Le passé russe, voire soviétique, ne semble pas poser de problème à ceux que nous avons rencontrée, dès lors que les identités/nationalités sont toutes respectées et admises. Ici on se présente d’abord comme Kirghiz, Ouzbek, Ouïgour, Indien, Chinois, Russe…
Le contraste avec l’Ouzbékistan est total : il y a bien, sur d’anciennes enseignes, et sur des panneaux officiels ou touristiques, des mentions ou des textes en langue russe, mais langue ouzbèke prédomine, même si dans plusieurs villes comme Samarcande, c’est le tadjik – proche du turc – qui est parlé majoritairement. Dans toutes les villes, les musées, les lieux historiques, visités, on n’a pas manqué d’incriminer d’abord la Russie tsariste, mais surtout la période soviétique, qui, selon nos interlocuteurs, ont pillé les richesses du passé, fait table rase des héritages si divers des empires révolus, parfois au sens propre du terme en détruisant citadelles, places fortes et mosquées.
Sur la guerre en Ukraine, c’est partout un silence plutôt gêné : il ne faut pas se fâcher avec le grand voisin, qui en retour laisse ces ex-républiques soviétiques tranquilles.
Spécialités locales
On ne partait pas en Asie centrale pour faire de la gastronomie, mais comme au Ladakh l’an dernier, se nourrir de toutes les ressources de terres riches et abondantes. Les légumes et les fruits ont du goût, un goût qu’on a fini par oublier sur nos marchés européens. Des pommes, des abricots, des pêches, des framboises juteux et sucrés, des tomates pleines et goûteuses, des pastèques et des melons par centaines, des viandes tendres issues des troupeaux locaux de vaches, moutons… et chevaux ! Les préparations en revanche manquent singulièrement de variété, inévitables salades de tomates, concombres et oignon frais, soupes de riz ou de lentilles, aubergines frites, et l’incontournable « plov« , variante de notre riz Pilaf… Le dessert ne fait pas partie d’un menu habituel. Evidemment pas d’alcool à table, mais toujours du thé noir ou vert.



Le chapitre serait incomplet si l’on ne mentionnait ce qu’on a probablement le plus souvent mangé, tant au Kirghizistan qu’en Ouzbékistan, où il faut toujours se méfier de la générosité des portions servies. Ainsi de cette « entrée » qui suffisait largement à faire mon repas, et qui est connue de tous, servis dans tous les établissements sous l’appellation de « A-li-vié. Nos premières guides furent surprises que nous ne connaissions pas la fameuse salade Olivier avec ce nom si français. Elles éclatèrent de rire lorsqu’on leur répondit que nous nommions ce plat « salade russe » ou « macédoine », Et que nous en ignorions l’inventeur, un chef franco-belge installé en Russie du nom de Lucien Olivier, mort à 45 ans… étouffé par sa propre salade !

En voiture
Dans les deux pays, on conduit à droite, sur des routes dont on va dire charitablement qu’elles ne sont pas toutes aux normes européennes. Mais on sent un effort pour améliorer la situation : plusieurs axes importants sont en travaux.
Au Kirghizistan, le parc automobile est assez varié, souvent ancien (beaucoup d’anciennes Lada soviétiques surtout dans les campagnes), voitures chinoises, japonaises (avec volant à droite !), coréennes, quelques très rares russes.
En Ouzbékistan en revanche, le marché est quasi complètement dominé par le constructeur local… Chevrolet, ex-Daewoo, au point que notre guide kirghize ignorait que c’était un des fleurons de l’industrie automobile américaine !
Culte
Le culte des héros est une constante des pays autocratiques. Même devenus démocratiques.


à Bichkek, Lénine et Kurmanjan Datka (1811 – 1907) : Album photos complet ici


Timur/Tamerlan à Samarcande et dans sa ville natale (albums photos ici)


Le dictateur-président de l’Ouzbékistan de 1991 à 2016, Islam Karimov.
Rappel pour mémoire des articles relatant ce voyage :
Dans les steppes de l’Asie centrale