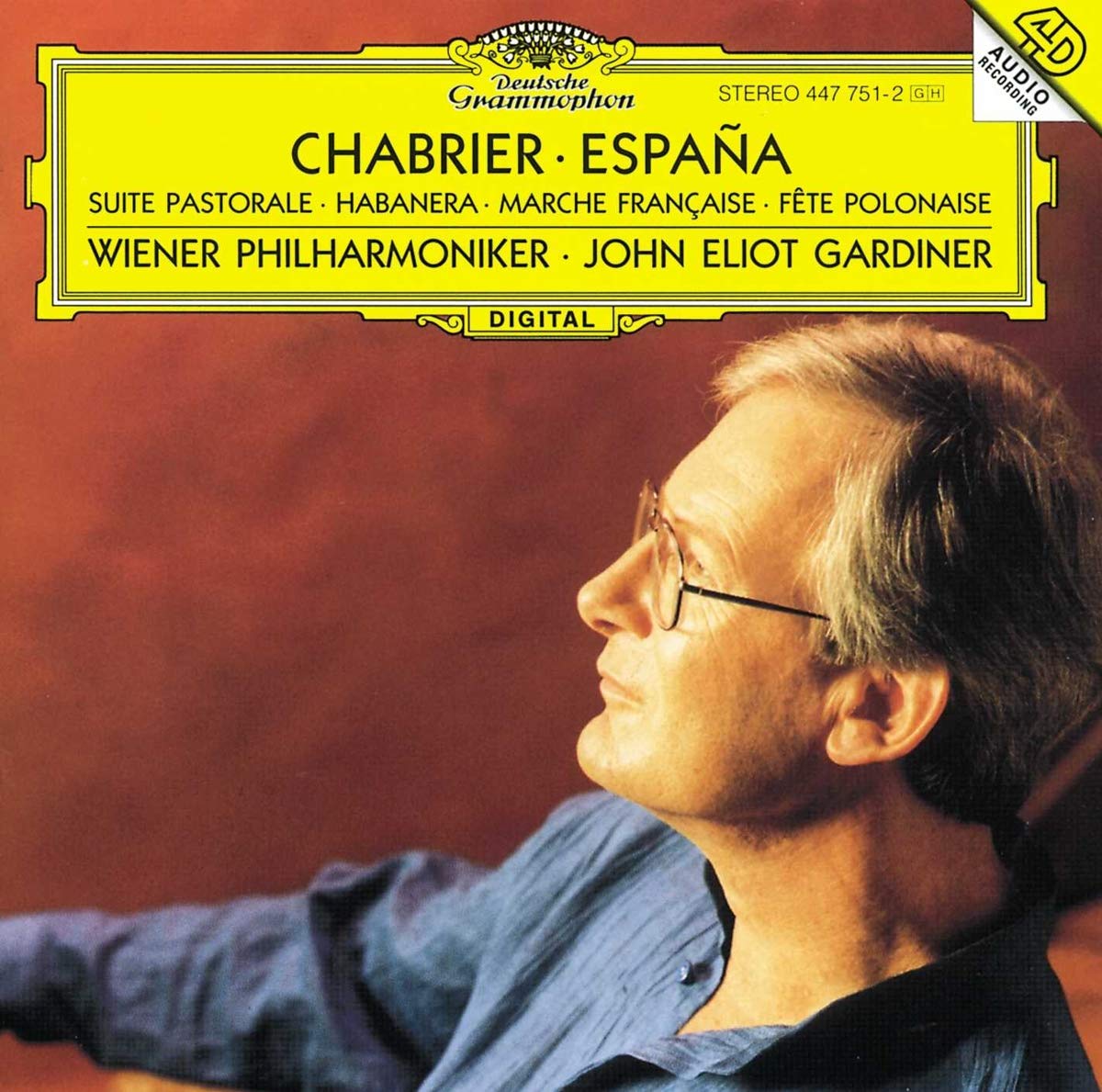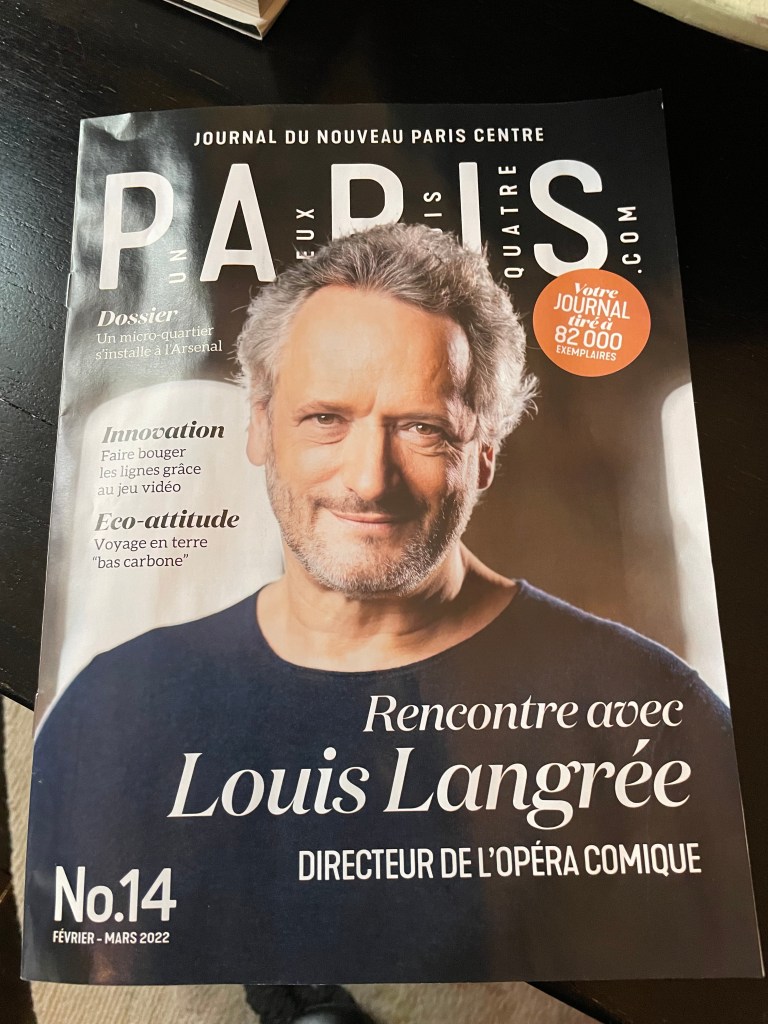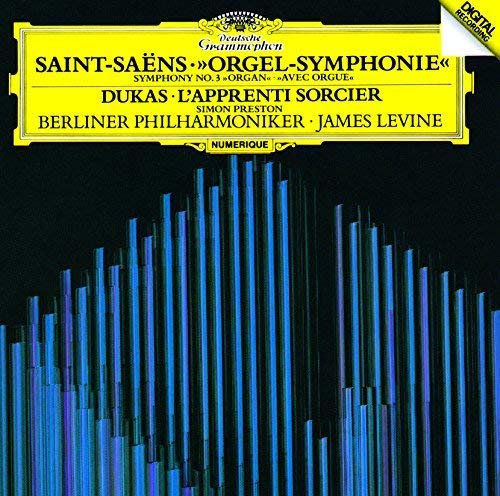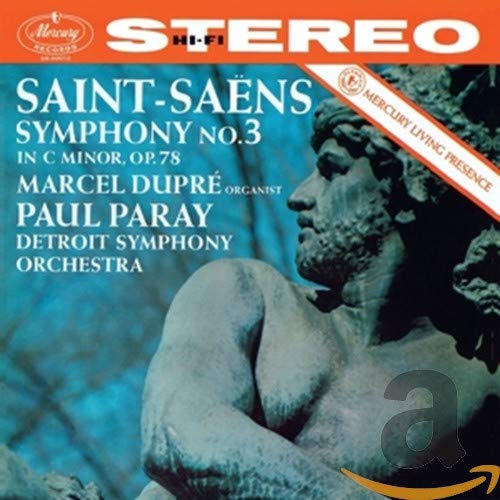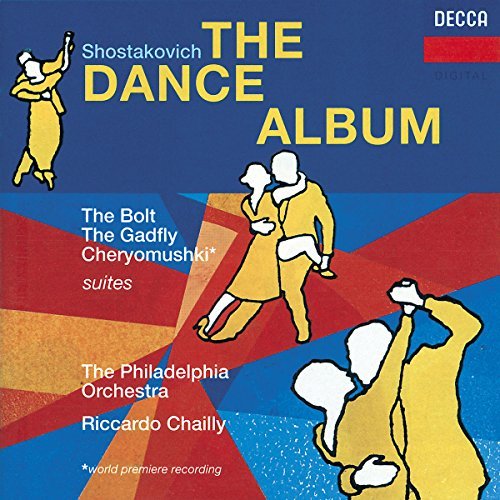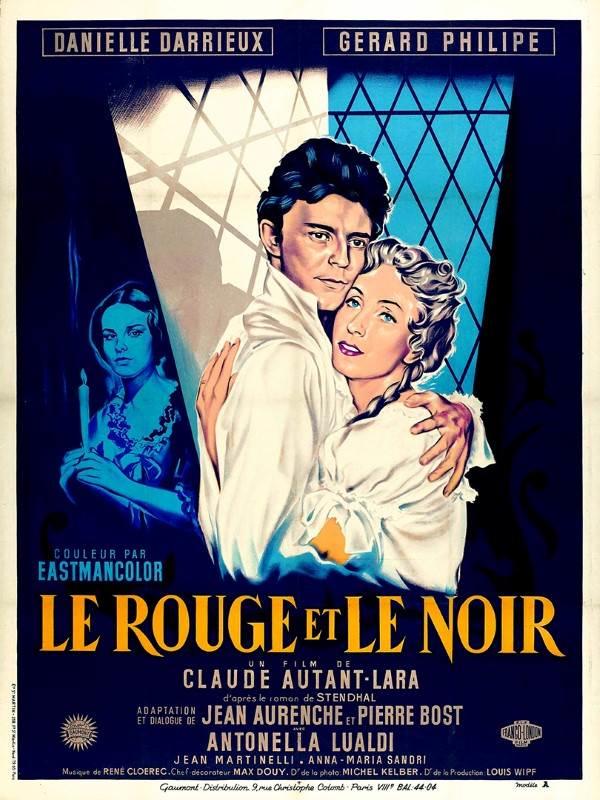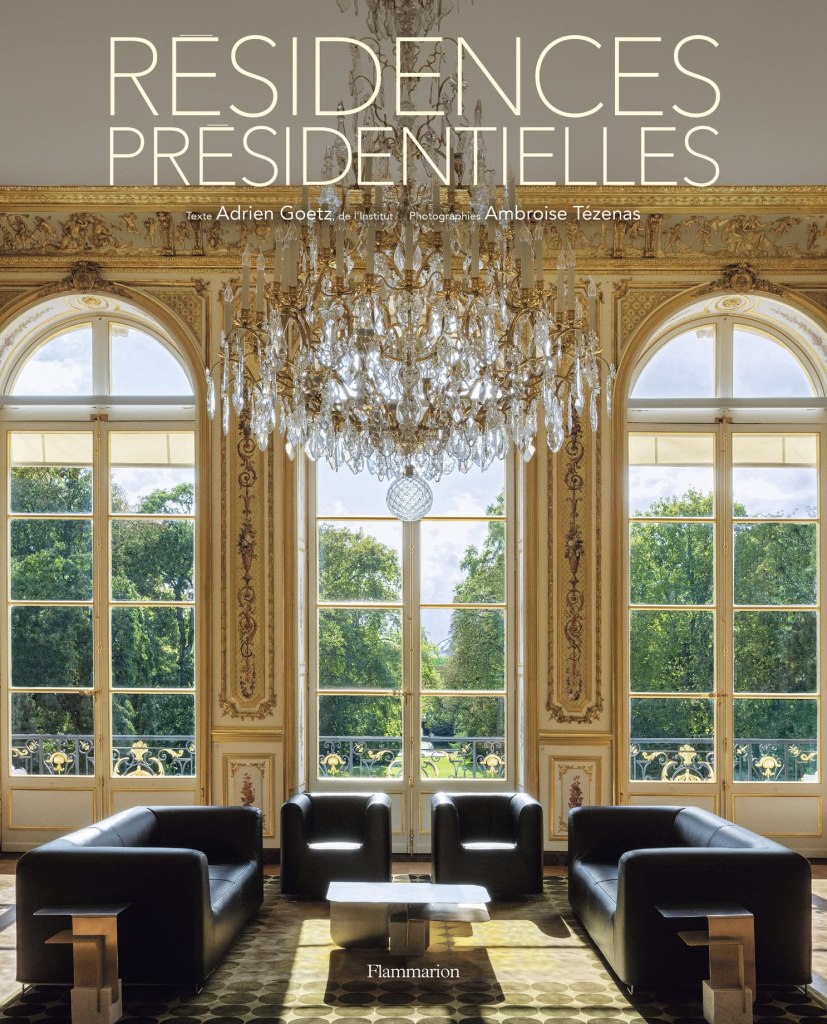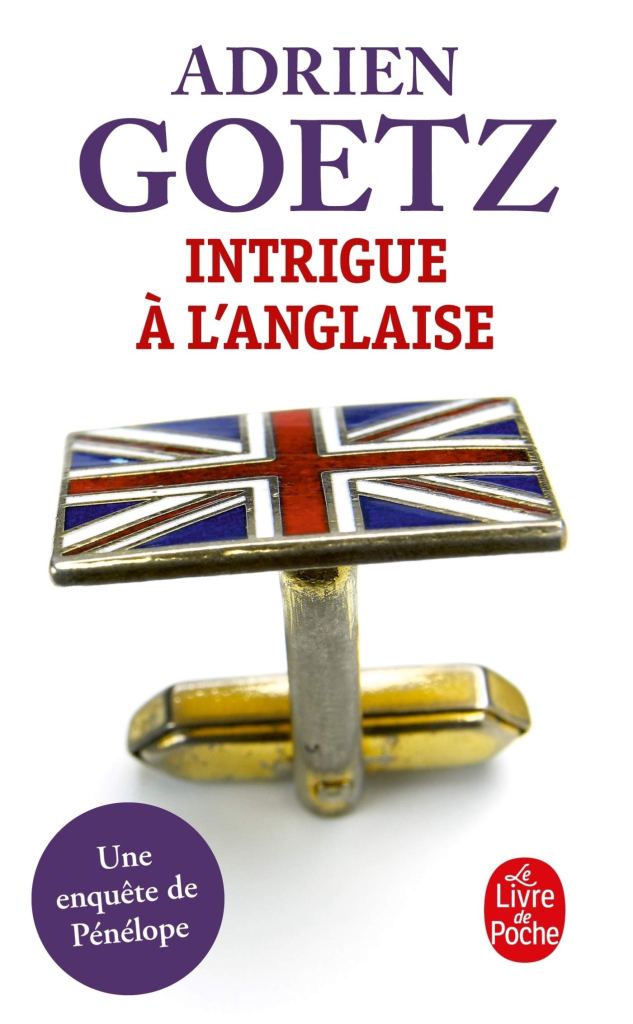On n’oublie pas l’Ukraine loin de là (Unis pour l’Ukraine), on a parfois honte de certains débats ou de certaines prises de position (lire à ce sujet l’excellent billet du jeune musicologue Tristan Labouret sur Facebook)
Mais on vient de passer deux soirées bienfaisantes, l’une au théâtre, l’autre à la Philharmonie de Paris. Récit.
L’inconnu d’Agatha C.
Cela fait un moment que j’avais repéré ce spectacle qui se donne depuis le 24 janvier dans un théâtre – une salle moderne du 11ème arrondissement – où je n’avais jamais mis les pieds, l’Artistic Athévains

Je suis depuis mon adolescence un lecteur et un fan d’Agatha Christie, on connaît ses « recettes » pour nouer des intrigues policières et dérouter ses lecteurs jusqu’à la fin. Ses pièces de théâtre sont moins fréquentes. Raison de plus pour assister à ce Visiteur inattendu.

Le « pitch » est simple, trop simple pour être honnête évidemment ! Un soir de brouillard, un homme survient dans une maison isolée, sa voiture ayant versé dans le fossé, il arrive sur une scène de crime, un homme tué par balles dans une chaise roulante et lui faisant face une femme tenant un revolver et expliquant qu’elle vient de tuer son mari. On se doute que, comme dans tous les romans et les pièces d’Agatha Christie, tous les personnages qui vont intervenir ont tous une raison d’être impliqués dans ce crime, on ne dira évidemment pas qui est le coupable !
Ce qui est admirable dans ce spectacle, c’est d’abord une mise en scène astucieuse, judicieuse de Frédérique Lazarini, c’est la densité de chacun des personnages, chacun des rôles, et l’excellence de tous les interprètes : Sarah BIASINI, Pablo CHERREY-ITURRALDE, Cédric COLAS, Antoine COURTRAY, Stéphane FIEVET, Emmanuelle GALABRU, Françoise PAVY, Robert PLAGNOL.
Cela se joue encore jusqu’à fin avril !
Yuja Wang, Klaus Mäkelä et Maurice Duruflé

Je n’avais pas encore eu l’occasion de voir et d’entendre le nouveau directeur musical de l’Orchestre de Paris, le jeune Finlandais Klaus Mäkelä qui vient de fêter ses 26 ans ! Le programme de cette semaine était, de surcroît, d’une originalité rare dans les concerts parisiens : l’Ebony concerto de Stravinsky, le Premier concerto pour piano de Rachmaninov et le Requiem de Maurice Duruflé.
Philippe Berrod ouvre le bal à la clarinette et s’amuse bien avec ses excellents collègues dans ce faux concerto faussement jazz mais vraiment Stravinsky sous la houlette élancée et élégante du jeune chef.
Puis vient le moins joué des quatre concertos de Rachmaninov qui servit – les moins de quarante ans ne peuvent pas connaître – d’indicatif à la mythique émission de Bernard Pivot Apostrophes (dans la version de Byron Janis).
Quel bonheur de voir entrer, moulée dans une robe jaune (l’Ukraine?), la pianiste chinoise Yuja Wang, une artiste qu’on tient pour véritablement exceptionnelle depuis qu’on l’a entendue notamment en 2014 à Zurich dans le 2ème concerto de Prokofiev, et un an plus tard avec Michael Tilson Thomas dans le 4ème concerto de Beethoven, c’était à la Philharmonie ! (Les surdouées).

Yuja Wang a cette sorte de charisme, de personnalité hors norme, qui emporte l’adhésion et la sympathie immédiates du public, elle manifeste une telle joie de jouer, se défiant de tous les obstacles techniques – son deuxième bis hier soir, les redoutables variations sur Carmen de Vladimir Horowitz, elle s’en amusait, elle s’en régalait, comme si aucune difficulté ne pouvait lui résister -, son contrôle du clavier est proprement sidérant.
Requiem pour la paix
En dehors du disque (Michel Plasson) je n’avais jamais entendu en concert le Requiem de Maurice Duruflé (1902-1986), le chef-d’oeuvre choral de celui qui fut jusqu’à la fin de sa vie l’organiste de Saint-Etienne-du-Mont à Paris. La filiation avec Fauré est évidente (comme le couplage des deux oeuvres au disque). Le requiem de Duruflé a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1947

Hier, au-delà de la confirmation que Klaus Mäkelä est un chef très inspiré, en osmose avec son orchestre, on a vécu l’un de ces moments forts dans la vie d’un mélomane, dans une vie d’homme tout simplement. La puissance, la beauté, la cohésion des forces musicales – magnifique choeur de l’orchestre de Paris -, la présence de deux solistes ukrainiens, Valentina Plujnikova et Yuri Samoilov, le très long silence recueilli à la fin du requiem, avant que n’éclate un tonnerre d’applaudissements dans le public de la Philharmonie, particulièrement adressés aux deux interprètes ukrainiens, et au-delà d’eux, à tout un peuple martyr.