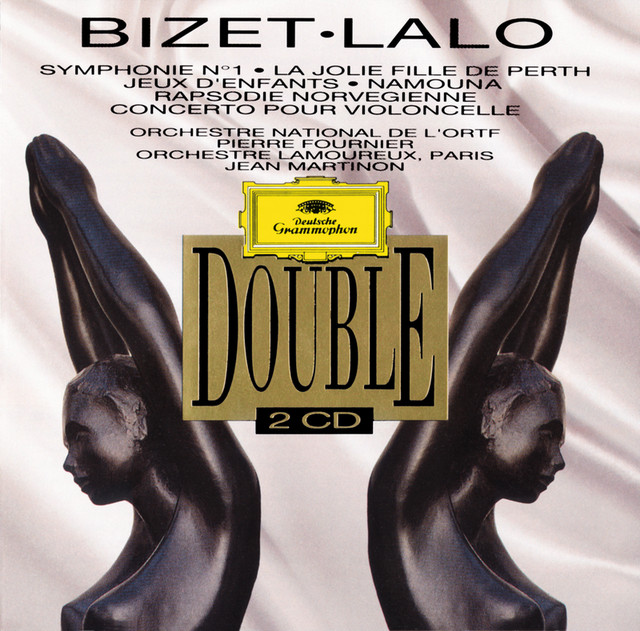Cette année de célébration du sesquicentenaire de la naissance de Ravel – le 8 mars 1875, s’est achevée à Paris par deux concerts d’exception, comme je le relate pour Bachtrack : L’accomplissement ravélien d’Alain Altinoglu

Il y avait d’abord… une création, la première audition publique de Semiramis, les esquisses d’une cantate que Ravel avait prévu de présenter pour le Prix de Rome en 1902. Lire la note très complète que publie le site raveledition.com.
Ici la création à New York, de la première partie – Prélude et danse
Mais le clou de cette soirée parisienne, ce fut l’intégrale de Daphnis et Chloé, une partition magistrale, essentielle, qu’on entend trop peu souvent en concert. Je lui avais consacré un billet en mars dernier (Ravel #150 : Daphnis et Chloé) en y confiant mes références, qui n’ont guère changé. Mais j’ai un peu revisité ma discothèque, où j’ai trouvé 24 versions différentes, qui ont toutes leurs mérites – il est rare qu’on se lance dans l’enregistrement d’une telle oeuvre si l’on n’a pas au moins quelques affinités avec elle ! Je ne vais pas les passer toutes en revue, mais m’arrêter seulement à celles qui, en plus des versions déjà citées comme mes références, attirent l’oreille.
- Claudio Abbado, London Symphony Orchestra (1994)
- Ernest Ansermet, Orchestre de la Suisse romande (1958)
- Leonard Bernstein, New York Philharmonic (1961)
- Pierre Boulez, Berliner Philharmoniker
- Pierre Boulez, New York Philharmonic
- André Cluytens, Société des Concerts du Conservatoire
- Stéphane Denève, Südwestrundfunk Orchester
- Charles Dutoit, Orchestre symphonique de Montréal
- Michael Gielen, Südwestrundfunk Orchester
- Bernard Haitink, Boston Symphony Orchestra
- Armin Jordan, Orchestre de la Suisse romande
- Philippe Jordan, Orchestre de l’Opéra de Paris
- Vladimir Jurowski, London Philharmonic Orchestra
- Kirill Kondrachine, Concertgebouw Amsterdam

Après maintes écoutes et réécoutes, c’est bien ce prodigieux « live » à Amsterdam qui tient le haut du pavé
- Lorin Maazel, Cleveland Orchestra
- Jean Martinon, Orchestre de Paris
- Pierre Monteux, London Symphony Orchestra (1962)
- Pierre Monteux, Concertgebouw Amsterdam (1955)
- Charles Munch, Boston Symphony Orchestra
- Seiji Ozawa, Boston Symphony Orchestra
- André Previn, London Symphony Orchestra
- Simon Rattle, City of Birmingham Symphony Orchestra
- François-Xavier Roth, Les Siècles

- Donald Runnicles, BBC Scottish Symphony Orchestra
Quelques autres recommandations en cette fin d’année.
Pour le piano de Ravel, je ne suis pas sûr d’avoir déjà mentionné la belle intégrale qu’en a réalisée un pianiste trop discret, François Dumont
Je n’ai pas encore évoqué non plus le dernier disque de Nelson Goerner, impérial dans les deux concertos pour piano.
Humeurs et bonheurs du jour à suivre sur mes brèves de blog