Certains me reprochent d’être trop sévère dans les critiques que j’écris pour Bachtrack.
Cherchez le chef !
Dernier exemple en date : la Walkyrie donnée actuellement à l’Opéra Bastille. (La Walkyrie de Calixto Bieito pète un câble à l’Opéra Bastille).

Extrait :
« La direction de Pablo Heras-Casado ne sortira jamais d’une platitude soporifique, d’une lecture sans relief que ne compensera pas la qualité d’ensemble de l’orchestre« .
D’autres consoeurs et confrères trouvent que la direction du chef espagnol s’est améliorée depuis L’Or du Rhin, ou même qu’après un début timide, elle a trouvé ses marques en cours de représentation (c’était la première de la Walkyrie ce 11 novembre).
J’ai été rassuré de lire sous la plume de Christian Merlin dans Le Figaro, un titre et un constat que je partage totalement : La Walkyrie à l’Opéra Bastille à bâiller d’ennui.
« S’ennuyer à l’acte I de La Walkyrie, l’heure de musique la plus incandescente et l’heure de théâtre la plus torrentielle jamais écrites, était-ce donc possible ? Pressenti un temps comme directeur musical de l’Opéra de Paris, Pablo Heras-Casado sait maintenant qu’il ne le sera pas. Sage décision, tant l’éclectique et talentueux chef espagnol peine à imprimer une marque et une ligne directrice à sa direction linéaire, sans ces reliefs et contrastes qui font ressembler l’orchestre wagnérien à un oscillographe« .
En effet, chez Wagner plus que chez tout autre compositeur d’opéra, c’est le chef d’orchestre qui est le personnage le plus important. Quand on compare les versions, par exemple, de la Tétralogie, on parle de celles de Böhm, Karajan, Solti, Sawallisch, etc. Dans le cas de celle qui nous occupe à Paris, on ne peut pas simplement dire que les chanteurs sauvent la mise.
Le son du violon
Le 2 septembre dernier, j’assistais au premier concert d’une nouvelle série proposée par la Philharmonie de Paris, les Prem’s (référence évidente aux célèbres Prom’s londoniennes). Le titre de mon article est éloquent : Succès total pour la première des Prem’s avec le Gewandhaus de Leipzig.
Mais, à propos du concerto pour violon de Dvořák qui y était joué, je notais :
« C’est Isabelle Faust qui officie. C’est bien, c’est très bien, techniquement irréprochable, mais dans cette œuvre hybride il manque le grain de folie, la liberté rhapsodique, un son de violon plus personnel.«
La violoniste allemande joue partout, fait des disques, et pourtant je serais incapable de dire et décrire en quoi elle est remarquable, singulière.
Ce n’est pas affaire de génération, on ne peut pas toujours se référer aux gloires du passé. La preuve avec deux autres concerts que j’ai chroniqués récemment :
María Dueñas (22 ans) était, pour moi, une découverte, en octobre dernier, avec l’Orchestre national de France et Manfred Honeck : « La jeune violoniste espagnole s’impose par une sonorité qui nous captive, une technique qui nous éblouit, et plus encore par une personnalité qui nous subjugue par sa lumineuse simplicité, le rayonnement d’un jeu qui transcende la difficulté avec un naturel confondant.«
Quant à Anne-Sophie Mutter, ce n’est plus une révélation, mais la confirmation que, cinquante ans après ses débuts sous l’égide de Karajan, elle a un son, un jeu, une personnalité reconnaissables entre tous, comme elle en témoignait encore en trio avec Pablo Ferrandez et Yefim Bronfman le 23 octobre dernier (Un trio radieux à la fondation Vuitton) : « On va enfin retrouver le son si chaleureux, reconnaissable entre tous, d’Anne-Sophie Mutter, ce vibrato serré dont elle usait parfois jadis avec excès«
Je n’ose même pas évoquer les mânes de Milstein, Ferras, Menuhin, Heifetz, et d’autres, tous ces glorieux archets qu’on reconnaît à première écoute.
De la personnalité svp !
De quelques années (!) d’expérience comme directeur d’un orchestre et d’une salle de concert (Liège), puis des forces musicales de Radio France et enfin du Festival Radio France à Montpellier, je tire toujours la même conclusion. Le public n’adhère qu’aux véritables personnalités, chefs, solistes, chanteurs, celles qui projettent ce quelque chose d’indéfinissable et pourtant de très perceptible qu’on nomme charisme, aura ou rayonnement. Contrairement à ce qu’on croit – surtout quand on ne fréquente pas les salles de concert ! – le public n’aime pas l’esbroufe et l’artifice.
J’ai en mémoire deux souvenirs parallèles de deux stars du piano : un concert à Londres il y a une douzaine d’années, où Lang Lang jouait le concerto de Ravel (avec Daniel Harding et le London Symphony, avant un départ en tournée asiatique). Après une interprétation complètement hors sujet du Ravel, Lang Lang revient jouer un « bis » genre romance chinoise à l’eau de rose avec force expressions et contorsions. La réponse du public est sans appel : le pianiste a juste le temps de regagner les coulisses avant que cessent les maigres applaudissements qui « saluent » sa prestation. Il n’est que de le comparer à sa compatriote Yuja Wang, qui, indépendamment de ses tenues , suscite toujours la sympathie immédiate du public, parce qu’elle est époustouflante certes, mais surtout parce qu’elle a un tel plaisir communicatif de jouer et de rejouer (lire Le phénomène Yuja)
Et toujours humeurs et bonheurs du jour dans mes brèves de blog



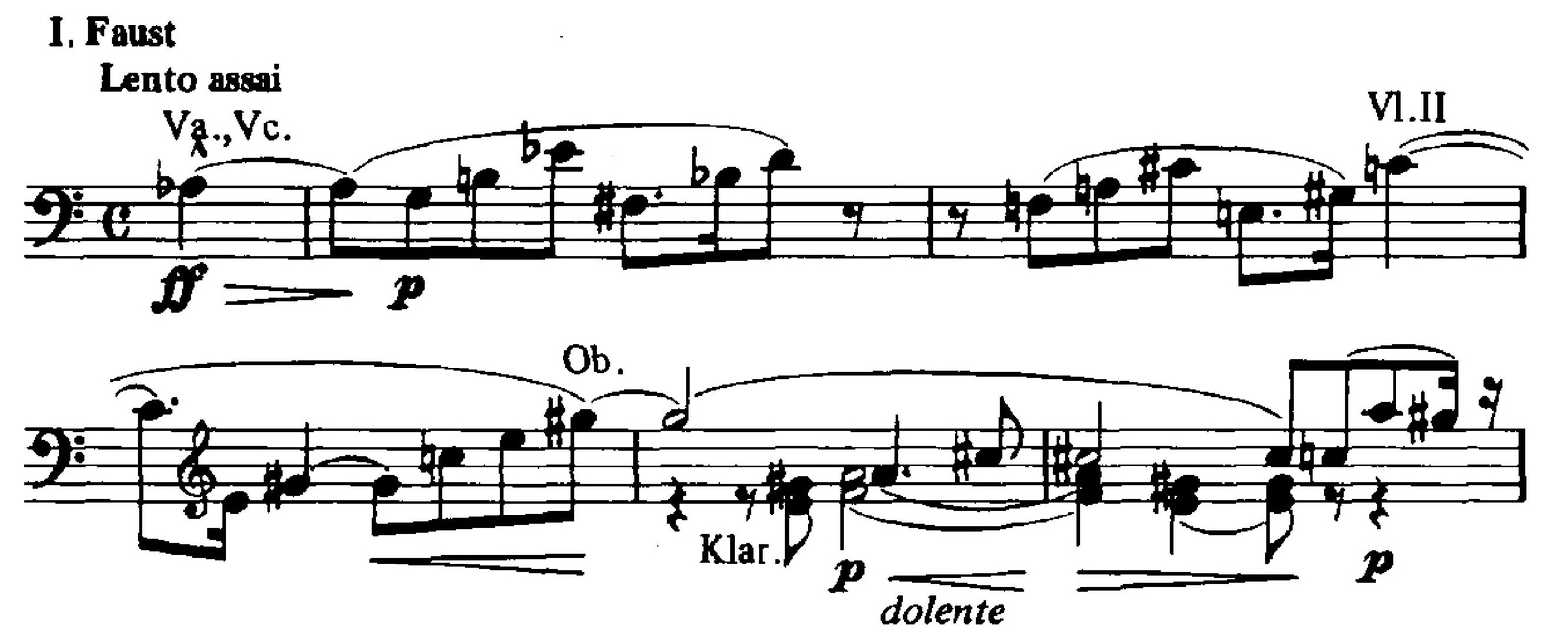

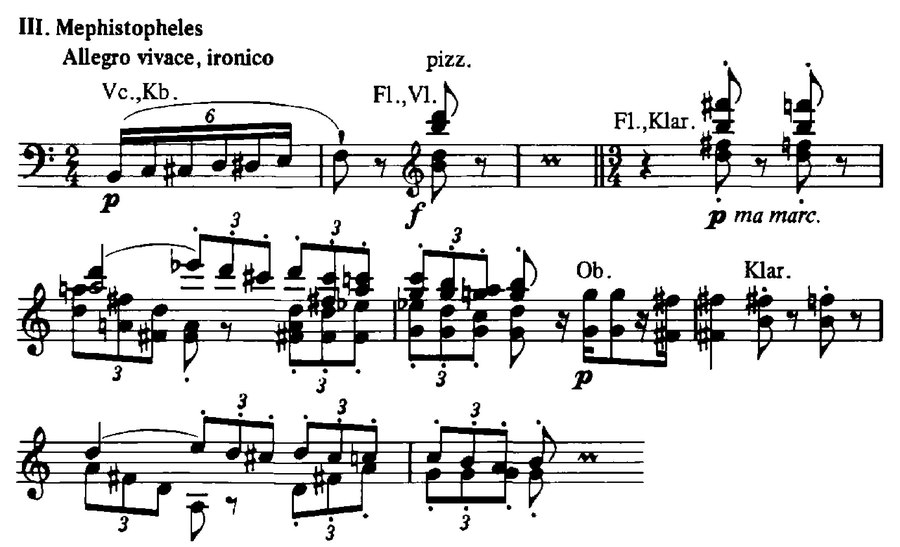














 J’attends avec impatience l’émission
J’attends avec impatience l’émission 