Quand je dis Nelson je pense spontanément à mes amis pianistes, le très regretté Nelson Freire, et le toujours bien vivant Nelson Goerner. Mais ce soir je repense avec émotion au chef américain John Nelson (1941-2025) qui vient de disparaître après une terrible maladie qui l’avait défiguré et pourtant pas empêché de poursuivre sa tâche jusqu’au bout de ses forces

Je veux d’abord citer Alain Lanceron, le patron de Warner et Erato :
« Nous n’oublierons pas le véritable amour qu’il éprouvait pour la musique et les musiciens, et pour ses deux compositeurs fétiches, Haendel et Berlioz. Nous n’oublierons pas non plus son enthousiasme, sa bonté, son humanité. John Nelson est mort lundi, un mois seulement avant les séances d’enregistrement que nous avions prévues à Strasbourg pour achever son cycle Berlioz. J’ai la chance de pouvoir me rappeler les 20 projets sur lesquels nous avons travaillé ensemble sur une période de trois décennies. La plupart d’entre eux étaient avec l’Ensemble Orchestral de Paris dont il a été directeur musical pendant 11 ans (de 1998 à 2009), et avec l’Orchestre philharmonique de Strasbourg pour un cycle Berlioz qui constitue un jalon dans l’histoire de l’enregistrement, en particulier Les Troyens avec Joyce DIDonato, Michael Spyres, Marie-Nicole Lemieux et une superbe équipe de chanteurs français. Juste y penser me fait venir les larmes aux yeux«





Série à laquelle il faut ajouter une de mes références de toujours des Nuits d’été de Berlioz

J’ai deux souvenirs personnels forts de John Nelson.
À Besançon en 1995, comme je l’ai raconté sur ce blog » je reçois une nouvelle invitation à siéger au Concours de jeunes chefs d’orchestre (j’y avais déjà siégé en 1992) Entre-temps je suis devenu directeur de France Musique (depuis l’été 1993), une absence d’une semaine de Paris n’est pas très bien vue par mes patrons de Radio France, mais le prestige du concours, etc… Cette année-là le jury est présidé par John Nelson. Personne parmi les candidats ne se détache vraiment, certains ne sont pas prêts – c’est le cas du fils d’un chef d’orchestre français, qui depuis a pris un bel envol, mais à qui John Nelson et d’autres membres du jury avaient dû expliquer amicalement qu’il devrait mûrir et s’aguerrir ). Un premier prix est attribué à un jeune Japonais, dont je n’ai plus jamais entendu parler depuis…
C’est finalement le lot de tous les concours, qui ne sont jamais une garantie de carrière pour les lauréats, mais qui, parfois, révèlent d’authentiques talents. Et pour qui a, comme moi, eu la chance de siéger dans plusieurs jurys, c’est sans doute l’expérience la plus enrichissante sur le plan artistique et humain. On ne voit plus jamais les artistes de la même manière, on mesure le courage, l’énergie, l’abnégation qu’il faut à un jeune musicien, au-delà de ses qualités musicales, d’abord pour affronter ces compétitions inhumaines, ensuite pour se lancer dans une carrière complètement aléatoire.«
L’attitude de John Nelson pendant toutes les épreuves du concours, sa bienveillance, même quand nous manifestions notre impatience ou notre mécontentement face à l’impréparation manifeste de. certains candidats, est restée pour moi une leçon d’humanité.
Le second souvenir c’est l’invitation que j’avais faite à John Nelson de venir diriger la 6e symphonie de Mahler à Liège en 2005 (lire la critique de ResMusica).
Et puis bien sûr d’autres concerts à Paris, avec l’Ensemble orchestral de Paris auquel il aura assuré une renommée internationale. Souhaitons que Warner/Erato réédite une belle collection d’enregistrements qui font honneur à ce grand chef.



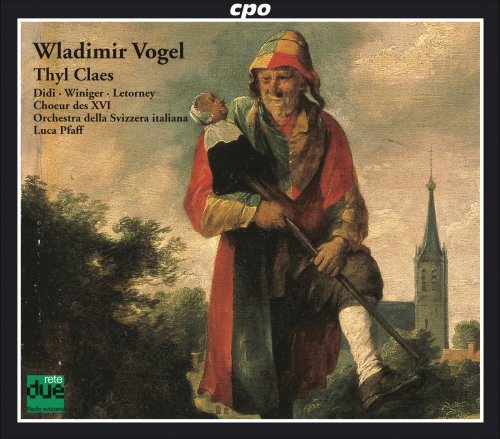



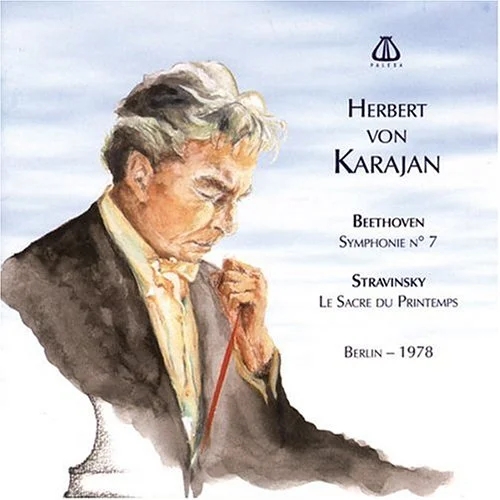

















 (Photo OPRL/Facebook)
(Photo OPRL/Facebook)







