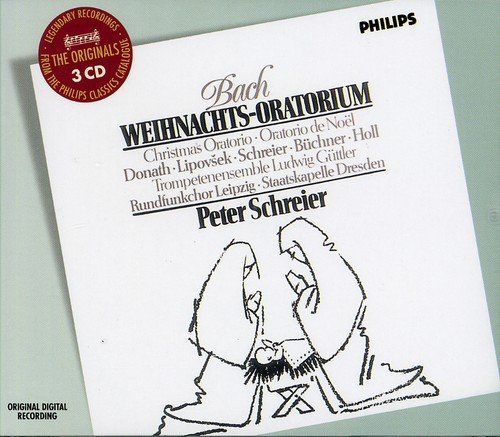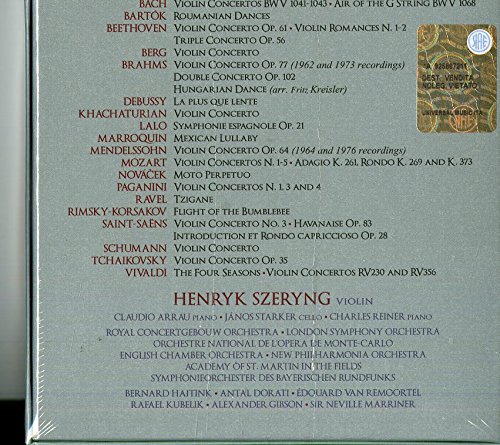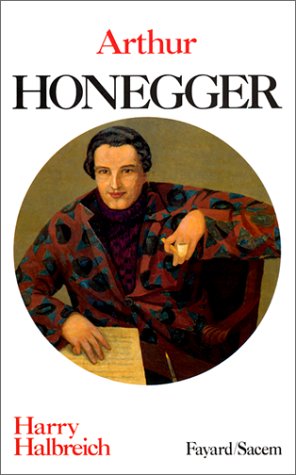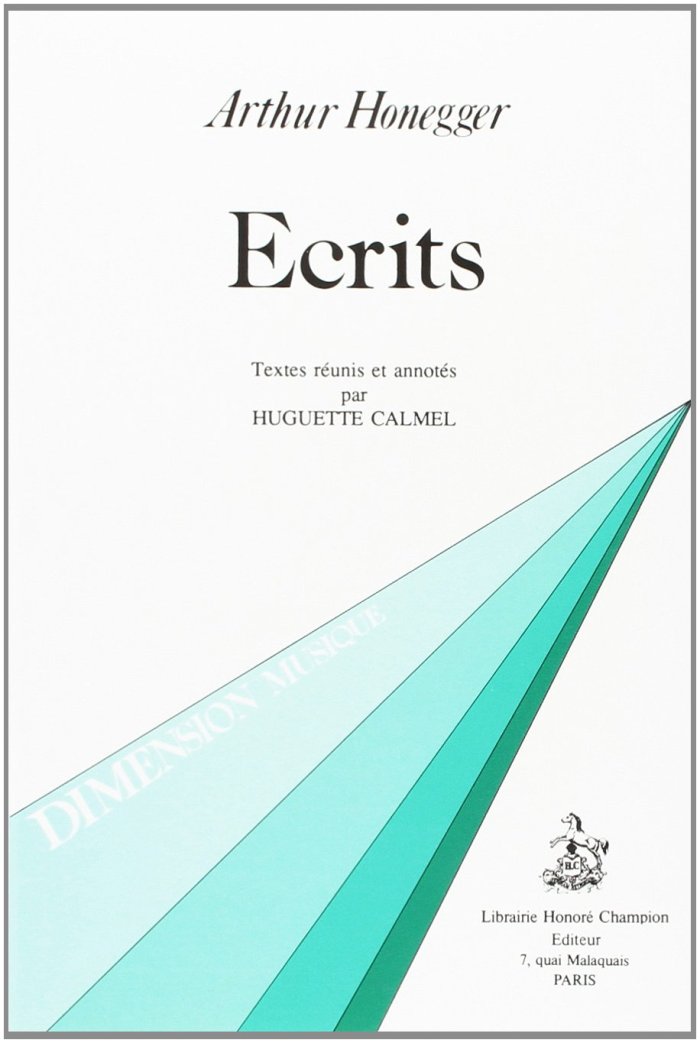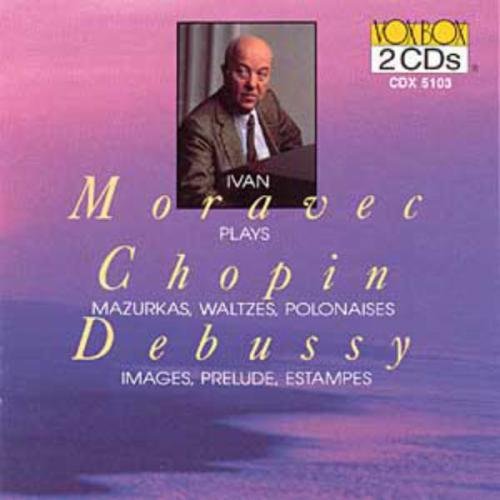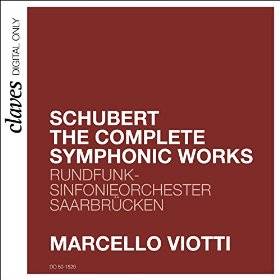Comme promis suite du premier volet : Il y a vingt-cinq ans : l’aventure France Musique (I).

Du changement du côté de la direction
Auprès de Claude Samuel, un changement important s’est opéré en cette rentrée 1993: son adjoint à la Direction de la musique, Stéphane Martin – croisé brièvement à Aix-en-Provence en juillet – quitte Radio France pour être bientôt le directeur de la musique du Ministère de la Culture (un poste occupé jadis par Maurice Fleuret, le véritable créateur de la Fête de la Musique auprès de Jack Lang). Stéphane Martin deviendra, en 1998, l’inamovible patron du Musée du quai Branly à la demande de Jacques Chirac. Il est remplacé, auprès de Claude Samuel, par Olivier Morel-Maroger, qui devient vite un complice et un ami et qui sera mon lointain successeur à la direction de France Musique (de 2011 à 2014).
Les producteurs et les équipes de France Musique commencent à rentrer, la plupart sont curieux de découvrir cet inconnu nommé « Délégué aux programmes » (un titre tellement incompréhensible que le successeur de Jean Maheu à la présidence de Radio France, Michel Boyon, me renommera « directeur délégué de France Musique… et des programmes musicaux de Radio France » !).
Hypothèses et rumeurs
Certains de ceux que j’ai connus lors de la journée commune F.M./Espace 2 (cf. L’aventure France Musique) se réjouissent de mon arrivée, à laquelle, me confient certains, ils ne seraient pas étrangers. M’ayant fait comprendre ce que je leur dois, ils comptent sur moi pour changer les choses… pour les autres, préserver voire augmenter leur pré-carré, égratignant l’équipe sortante et surtout Claude Samuel… dont je dois me méfier !!
En réalité, ils ne comprennent pas pourquoi j’ai été nommé, pourquoi moi… et comme il faut bien inventer une explication quand les faits sont trop simples, j’apprendrai quelques semaines plus tard que j’ai été poussé là par le ministre RPR de la Culture d’alors, Jacques Toubon – d’ailleurs tout le monde sait que je suis RPR !! (lire sur mon passé « politique » Les années Bosson) – pour contrebalancer l’influence de Claude Samuel réputé de gauche. Evidemment je n’ai jamais rencontré Toubon auparavant, encore moins bénéficié de l’appui de quiconque au gouvernement ou dans un parti. Le seul ami que j’ai, dans le gouvernement d’Edouard Balladur, est le maire centriste d’Annecy, Bernard Bosson, ministre de l’Equipement, des Transports et du Tourisme, avec qui je suis en froid depuis quelques mois, et à qui j’apprendrai ma nomination, une fois installé à Paris…
Je suis trop attaché à ma liberté, à mon indépendance, pour ne jamais avoir dépendu, dans ma vie professionnelle comme dans mon activité publique, de quelque « piston », réseau, obligation que ce soit. J’ai parfois payé le prix de cette indépendance – le chômage, l’incertitude, la défaite électorale – mais je ne l’ai jamais regretté.
Première visite des studios
L’une des premières choses que je demande à faire, dès mon arrivée dans la Maison ronde, est de visiter les studios de la chaîne. Il y a 25 ans, ceux-ci ne sont pas, comme aujourd’hui, installés au coeur des chaînes, mais dans ce qu’on appelle encore « la petite couronne », autrement dit dans l’espace situé entre la maison ronde telle que tout le monde la connaît de l’extérieur, et la tour centrale. Double explication : l’isolation phonique – puisque pas de contact avec l’environnement urbain – et les impératifs de Défense nationale !
Je « descends » donc – comme je le ferai quasi quotidiennement, week-ends compris, pendant près de six ans – voir les studios où se déroule l’essentiel des émissions de France Musique. Je salue les présents – je mettrai un peu de temps à comprendre les fonctions réelles de ceux que je croise, « chef de cabine », « chargé de réalisation », speaker ou speakerine, chargé(e) du relevé des droits d’auteur, technicien(ne)s, assistant(e)s de production. Bref, rien que de très normal pour un patron de chaîne ! J’apprendrai avec surprise – la rumeur court vite dans les couloirs circulaires de la Maison ronde ! – que j’ai fait très fort avec cette simple visite : mes prédécesseurs ne descendaient jamais en studio !
L’épaisseur d’une feuille de papier à cigarettes
Début septembre, j’ai suggéré à Claude Samuel – qui n’est pas très chaud – une rencontre entre lui, les producteurs de France Musique et du programme musical de France Culture (je reviendrai plus tard sur cet étrange « état dans l’Etat ») et moi, histoire de faire les présentations, d’expliquer un peu comment nous allons travailler et avec quels objectifs. Là encore, je découvrirai que ce genre de rencontre collective est une première (sauf par temps de grève !)
L’assemblée est nombreuse, intimidante.. et intimidée. Il faut un peu de temps pour que les questions sortent, on n’est jamais trop prudent surtout face à une nouvelle direction qui pourrait prendre ombrage de certaines impertinences. Mais en filigrane, on comprend bien que les producteurs veulent savoir ce qui va changer, puisque le directeur de la musique – qui a la tutelle des chaînes – n’a pas changé. Je m’entends répondre – ce que je pense vraiment – que :
- si Claude Samuel a fait appel à moi, c’est peut-être parce que je peux apporter une expérience, des idées, une perspective
- mais qu’il ne saurait y avoir, entre lui et moi, plus que « l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarettes ».
On me reprochera souvent cette remarque. Comme si, dans une équipe, on avait une chance quelconque de faire évoluer les situations, de faire bouger les choses, dans un conflit ouvert, public, entre numéro 1 et numéro 2. Toute mon expérience – même si je n’ai que 37 ans lorsque je prends mes fonctions – tant professionnelle, à la Radio suisse romande, que politique, comme Maire-Adjoint de Thonon-les-Bains, me dit qu’il n’y a pas d’autre voie que la force de persuasion, le pouvoir de conviction qu’on exprime dans une équipe et qui emporte – ou non – l’adhésion à une idée, un projet, un changement.
En tout cas, en cette rentrée 1993, je n’ai pas le sentiment de commencer une course d’obstacles, même si je percevrai vite l’incroyable lourdeur de l’organisation d’une Maison qui tient plus d’une administration de type soviétique que d’une entreprise de médias. Et je ne tarderai pas à croiser de fortes têtes. Portraits pour bientôt…

 (J’adore cette photo de notre premier Disques en Lice : de gauche à droite, François Hudry, votre serviteur avec lunettes et cravate (!!), Chiara Banchini, Michel Corboz et Pierre Gorjat)
(J’adore cette photo de notre premier Disques en Lice : de gauche à droite, François Hudry, votre serviteur avec lunettes et cravate (!!), Chiara Banchini, Michel Corboz et Pierre Gorjat)
 (Le joli
(Le joli 
 (De gauche à droite, François Hudry, JPR en cravate (!),
(De gauche à droite, François Hudry, JPR en cravate (!),