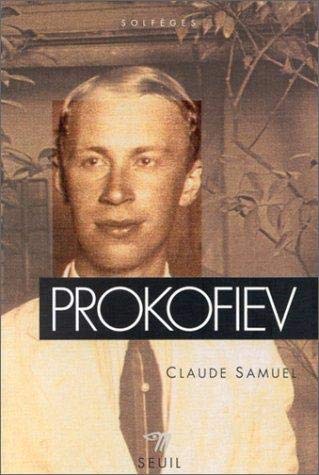Claude Samuel est mort ce matin, à quelques jours de ses 89 ans. Je le savais affaibli depuis plusieurs mois, mais jusqu’au bout alerte, s’informant de tout ce qui avait fait sa vie : la passion de la musique et des créateurs.
J’ai déjà raconté dans quelles circonstances j’ai été amené à travailler durant six ans avec lui et sous son autorité (L’aventure France Musique).
Le créateur de Présences
France Musique écrit ceci :
Diplômé de médecine en chirurgie-dentaire, Claude Samuel suit également des études musicales à la Schola Cantorum auprès de Daniel-Lesur. Très tôt, il rejoint le monde du journalisme et de la presse musicale mais aussi le monde de la radio, médium pour lequel il produira près de 1000 émissions au micro de France Culture et de France Musique.
Véritable titan du journalisme et de la radio musicale française, Claude Samuel est également une figure emblématique de l’histoire de Radio France en tant que producteur et Directeur de la Musique de Radio France (1989 à 1996).
Il était « l’homme de la musique contemporaine » selon Jean-Pierre Derrien, « l’oreille des musiciens » selon le Figaro, mais aussi un « bâtisseur d’institutions » selon le producteur Lionel Esparza. La carrière de Claude Samuel, qui occupe ces sept dernières décennies, est presque impossible à synthétiser. Journaliste de presse quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, il prête également sa plume à la presse musicale, notamment aux publications Harmonie, Le Panorama de la Musique, Musiques, La Lettre du musicien, et Diapason. Il est aussi l’auteur du « blog-notes de Claude Samuel », un blog musical sur le site qobuz.com qu’il alimentera jusqu’en novembre 2018.
Passionné de musique contemporaine, Claude Samuel est à l’origine de nombreux concours et festivals qui lui permettront d’encourager et de promouvoir cette musique auprès d’un public toujours plus large. En 1967, dans le cadre du Festival international d’art contemporain de Royan (1965-1972), il lance le « concours Messiaen » pour le piano contemporain. Il poursuit son rôle de passeur avec le Festival des arts de Persépolis (1967-1970) et les Rencontres internationales d’art contemporain de La Rochelle (1973-1979), puis les Rencontres de musique contemporaine de Metz et le Festival des arts traditionnels de Rennes.
Il est également initiateur de plusieurs concours de la Ville de Paris, tels que le Concours de flûte Jean-Pierre Rampal, le Concours de trompette Maurice André, le Concours de piano-jazz Martial Solal et le Concours de lutherie et d’archèterie Étienne Vatelot.
D’abord nommé conseillé pour la programmation et la production à Radio France, Claude Samuel occupe le poste de Directeur de la Musique dès 1990. Il lance la même année la première édition du festival « Présences », un festival de musique contemporaine alors gratuit qui réussit à rassembler un public vaste et varié.
Homme de culture, il est également à l’origine du Prix des Muses, qui récompense des ouvrages consacrés à la musique classique, au jazz et aux musiques traditionnelles (études musicologiques, biographies, romans…) et publiés en français au cours de l’année qui précède, repris par France Musique en 2017 pour devenir le Prix France Musique des Muses.
Par ses efforts, Claude Samuel apporte tout au long de sa carrière une aide considérable à la musique contemporaine à une époque où ce genre ne profite pas d’un soutien majeur. Il recevra la Légion d’honneur (1985) avant d’être nommé Officier des Arts et des Lettres et Officier de l’ordre du Mérite (1993).
Six ans en commun
Comme toute collaboration d’une certaine durée, celle qui m’a liée à Claude Samuel de 1993 à 1999, a été contrastée, chahutée parfois, mais toujours fondée sur un très grand respect de ma part pour quelqu’un qu’aucun obstacle, aucune mesure technocratique, ne semblaient pouvoir arrêter (lire L’épaisseur d’une feuille de papier à cigarette).
 (Photo Michel Larigaudrie)
(Photo Michel Larigaudrie)
A cette époque, France Musique (et le programme musical de France Culture) faisaient partie de la direction de la musique de Radio France. J’ai longtemps pensé – et je le pense toujours – que c’était une chance pour les antennes comme pour les formations musicales de Radio France.
Claude Samuel aimait animer des réunions, parfois longues, partant dans tous les sens, mais elles permettaient d’échanger idées, projets, programmes, par exemple pour organiser les saisons musicales autour de thèmes et de fortes personnalités (Liszt, Szymanowski – quel souvenir que cette version de concert du Roi Roger, l’unique opéra de Szymanowski, au théâtre des Champs-Elysées en janvier 1996 !). J’eusse aimé que, parfois, il montrât plus d’autorité sur les chefs des orchestres « maison » – Charles Dutoit pour l’ONF, Marek Janowski pour l’OPRF -, mais j’avais vite compris – ce que je vérifierai lorsqu’à mon tour j’occuperai la fonction de directeur de la musique en 2014 ! – que ces messieurs ne voulaient en référer qu’au PDG de Radio France (et encore…).
Mais quand Claude Samuel croyait à une idée, il n’en démordait jamais, se heurtant souvent de front à la direction de la Maison ronde, y compris au PDG de l’époque qui l’avait nommé, Jean Maheu. Il s’est battu pour Présences, fort de l’expérience acquise à Royan, avec une opiniâtreté que je n’ai plus rencontrée chez personne d’autre.
Journaliste de l’écrit il avait été, il tenait comme à la prunelle de ses yeux au mensuel Mélomane qui donnait à voir l’impressionnante activité musicale de Radio France. Une revue qui disparut dès qu’il ne fut plus là pour la défendre…
Claude Samuel se mit à dos la moitié de Paris, en organisant des séries de récitals et de musique de chambre… gratuits, que, pour certains (le dimanche matin) il présentait lui-même. Concurrence déloyale avec les deniers publics, tonnaient ceux et surtout celles qui se reconnaîtront !
En revanche, il se méfiait des producteurs de France Musique (parce qu’il l’avait été lui-même ?), ce qui, paradoxalement, me laissa une grande latitude pour faire évoluer non seulement la grille de la chaîne, mais aussi les pratiques de certaines fortes têtes,
Départ et retour
Nos relations auraient pu tourner vinaigre, surtout lorsque la rumeur se mit à enfler, dans les derniers mois de 1995, d’un départ de Claude Samuel de la direction de la musique. Michel Boyon avait succédé à Jean Maheu à la présidence de Radio France, et la fin du mandat de Maheu avait été source de frictions de plus en plus fréquentes avec Claude Samuel (au point qu’il m’était arrivé, à quelques reprises, d’être convoqué par le PDG pour faire passer des messages, sur certains dossiers sensibles,… à mon directeur !).
De là à ce qu’on me prête l’intention de succéder à Claude Samuel et toutes les manigances et manoeuvres qui vont avec… Ce qui n’était pas le cas, mais on ne peut empêcher les bruits de couloir (surtout dans une maison ronde !) de se nourrir du moindre signe pour prospérer !
Mais notre collaboration allait prendre un tour assez inattendu. Claude Samuel avait fait valoir notamment auprès de Patrice Duhamel, alors directeur général de Radio France, une clause de son contrat qu’il entendait faire exécuter : au terme de son mandat de directeur de la musique, il était prévu que Radio France confie une ou des émissions à Claude Samuel ! Celui-ci insista pour se faire confier rien moins que la matinale de France Musique, et « on » me fit savoir que cette position n’était pas négociable. J’obtins seulement que C.S. n’ait pas un statut d’extra-territorialité, mais qu’il exerce son activité de producteur sous l’autorité… du directeur de la chaîne ! Situation inédite, que, malgré certains entourages, nous parvînmes, Claude Samuel et moi, à surmonter.
Je veux garder le souvenir d’un personnage incroyablement curieux, enthousiaste, volontaire, fourmillant d’idées, d’un fabuleux collectionneur de documents, d’articles, d’autographes – je sais qu’il travaillait ces derniers mois à permettre que cette somme lui survive et serve aux chercheurs et historiens de la radio et de la musique.
Parmi tant d’instants partagés, me revient en mémoire une visite que nous avions faite à Londres, pour rencontrer des responsables de la BBC, voir le compositeur George Benjamin répéter avec l’orchestre de la BBC. Entre deux rendez-vous, j’avais entraîné Claude chez Foyles, le Gibert londonien sur Charing Cross. Il ne connaissait pas cette fabuleuse librairie, et son très vaste rayon de partitions et d’ouvrages sur la musique. Quel ne fut pas son bonheur de découvrir, en bonne place, la version anglaise de « son » Prokofiev, la première biographie en français, parue en 1960, du compositeur russe disparu en 1953.
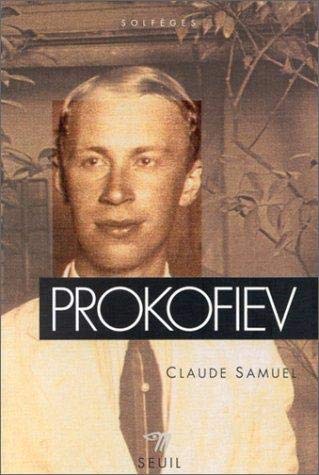






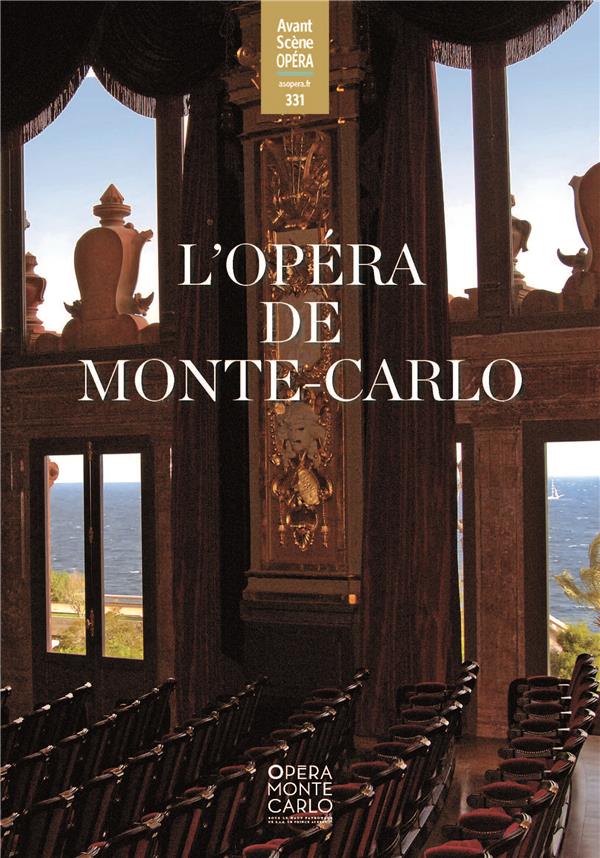

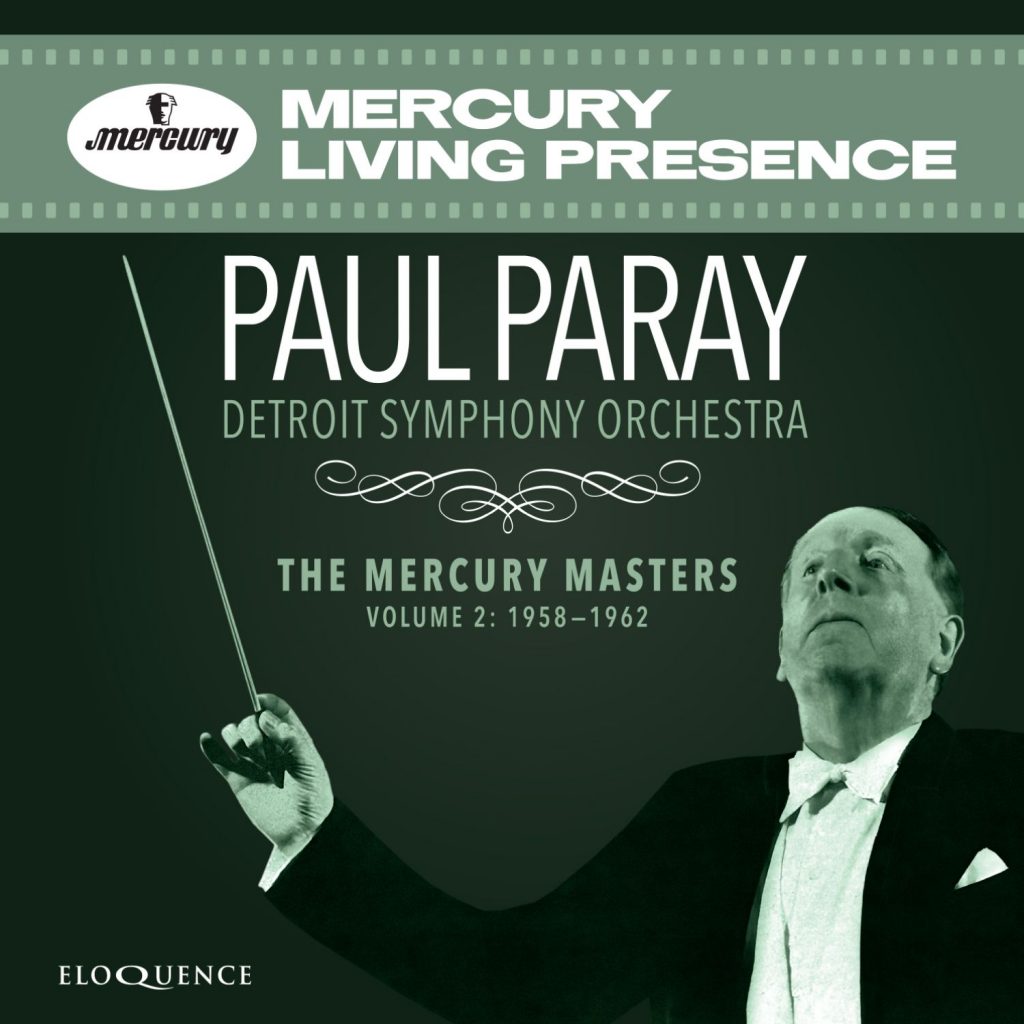
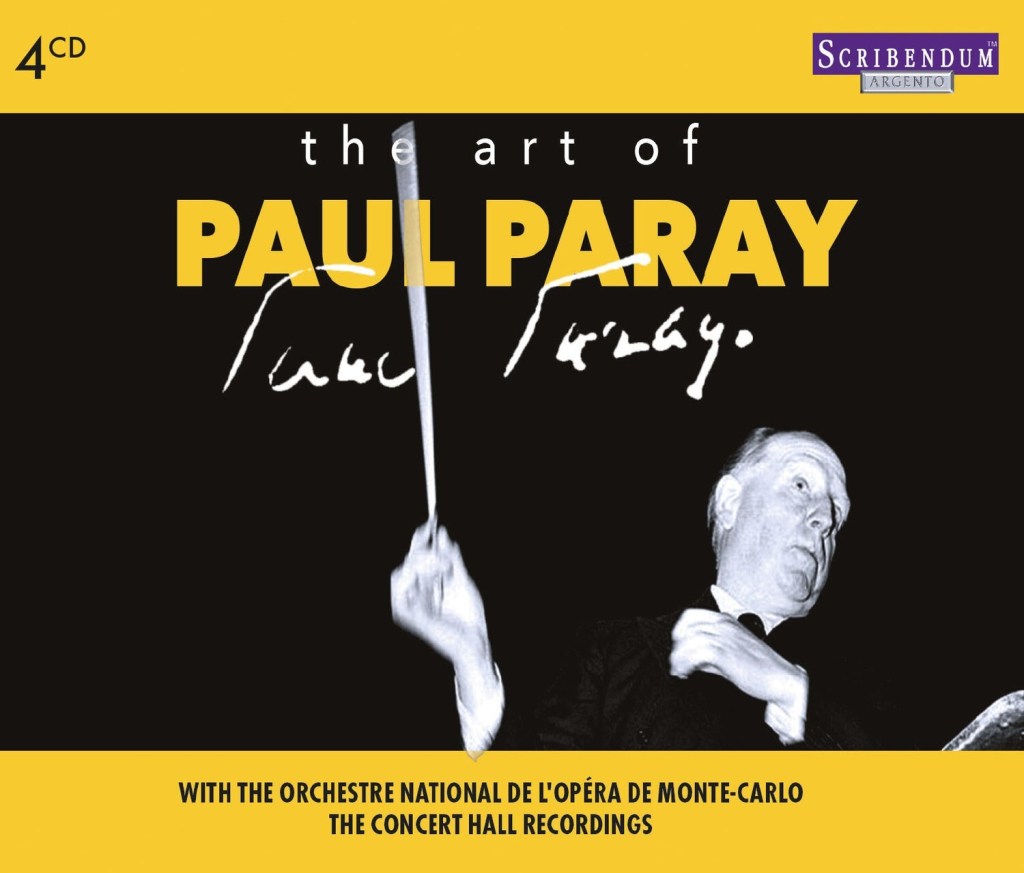









 (Photo Michel Larigaudrie)
(Photo Michel Larigaudrie)