La fin de la presse musicale ?

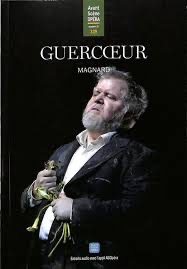

Hier c’est le rédacteur en chef de Diapason qui signait ces lignes :
« La nouvelle est tombée comme un couperet : le numéro de mars de Classica, a-t-on appris de plusieurs sources internes, devrait être le dernier, comme cela a été annoncé hier par leur direction aux salariés du titre, qui devraient donc être licenciés. Classica est publié depuis 2019 par les éditions Premières Loges, filiale du groupe Humensis spécialisé dans l’édition de livres (en particulier de manuels scolaires et universitaires). En difficultés, Humensis a été cédé il y a peu à Albin Michel, qui n’a pas souhaité poursuivre l’activité presse musicale. Outre Classica, le magazine Pianiste devrait lui aussi cesser de paraître, tout comme la revue L’Avant-scène opéra, joyau chéri par tous les lyricomanes – ces deux titres dépendant eux aussi des éditions Premières Loges. »
Depuis cette annonce, les témoignages de soutien et d’amitié fleurissent (Forumopera)
Je relève celui-ci, de Tristan Labouret, le jeune rédacteur en chef de l’édition française de Bachtrack : « Terrible nouvelle, terrible perte que ce magazine, pour lequel j’avais eu l’honneur d’écrire auprès de Philippe Venturini qui était un modèle de rédacteur en chef, et que je continuais à lire consciencieusement tous les mois. La disparition de Pianiste et de L’Avant-Scène Opéra est tout autant un drame, ces deux magazines étant des références inestimables dans leurs domaines. Tout le monde est concerné, tout le monde y perd aujourd’hui, journalistes, critiques, lecteurs, artistes, musicologues, organisateurs de concerts et j’en passe. En pensée avec toutes les équipes, les salariés et les pigistes, qui ont contribué à faire de ces magazines des oasis salutaires dans un milieu de la musique classique décidément de plus en plus aride. »
La rumeur courait depuis plusieurs mois à propos de Classica, mais on avait naguère entendu les mêmes à propos du concurrent (et ami) Diapason, lorsque le magazine avait changé de propriétaire. Quant à l’Avant-scène opéra, je me rappelle l’insistance que mettait son fondateur, Michel Pazdro, à nouer un partenariat avec France Musique il y a trente ans, parce que, me disait-il, déjà à l’époque le modèle économique d’une revue aussi spécialisée était d’une extrême fragilité.
Tout le monde y va de son analyse sur les causes d’une telle situation.
Je ne prétends pas ajouter la mienne, ni reprendre l’antienne du « c’était mieux avant ». Les regrets n’ont jamais servi à rien, encore moins à résoudre une difficulté.
Mais les constats sont là : pour des magazines spécialisés dans le disque classique, c’est la matière première qui, depuis une vingtaine d’années, vient à manquer. Les « majors » (Deutsche Grammophon, Decca, Warner, Sony) ont considérablement ralenti l’allure, les « nouveautés » se comptent sur les doigts des deux mains en année pleine. Ces nouveautés que les discophiles comme moi attendaient impatiemment de voir chroniquées dans leurs magazines favoris avant de se décider à acheter ou non, comparées avec les « références » précédentes.
Ces critiques étaient d’autant plus attendues, et lues, que c’était (en dehors des émissions de radio d’écoute comparée) souvent le seul moyen pour le modeste lecteur/discophile de se faire une opinion. Aujourd’hui, même pour celui qui persiste à acheter un support physique – CD, DVD ou vinyle – tous les moyens existent d’écouter, de comparer sur internet.
Face à cette paupérisation de la matière discographique, les grands magazines spécialisés (cela vaut aussi pour les très britanniques Gramophone ou BBC Music Magazine) se sont efforcés de diversifier leurs contenus, de créer de nouvelles rubriques, de capter peut-être ainsi de nouveaux lecteurs.
La vraie question – et je l’ai souvent développée ici (Le grand public)- est celle du public auquel s’adressent ces magazines spécialisés, comme d’ailleurs les sites en ligne.
Reste à souhaiter à celles et ceux qui se sont vu brutalement notifier la fin de l’aventure que d’autres supports, d’autres moyens d’expression leur soient offerts.
La messe à Notre Dame

J’avais eu la chance de chroniquer le premier concert donné à Notre Dame après sa réouverture le 17 décembre dernier (lire sur Bachtrack : La Maîtrise Notre Dame retrouve sa cathédrale.
J’y suis retourné mardi dernier pour un programme qui réunissait les deux Maîtrises de Notre Dame et de Radio France, avec leurs deux chefs respectifs, Henri Chalet et Sofi Jeannin : Deux Maîtrises pour Notre Dame.

Frustration de n’avoir entendu que la si brève Chanson à bouche fermée de Jehan Alain (1911-1940)
Je reconnais que je connais mal le frère aîné de Marie-Claire Alain. Il va falloir que je comble mes lacunes.
Bonheur d’entendre Frank Martin (1890-1974) et sa Messe pour double choeur a cappella, qui convient idéalement à l’acoustique de Notre Dame.
Plus grand monde ne sait qui est le compositeur suisse Frank Martin (lire Les sept instruments), on joue encore parfois ses deux pièces concertantes (la Petite symphonie concertante et le Concerto pour 7 instruments à vent et timbales). Alors que c’est l’une des personnalités les plus originales du XXe siècle. A recommander (et écouter) sans limite !


Mon journal à retrouver sur brevesdeblog
Pour être complet voici l’échange paru sur Linkedin :

Les bras m’en tombent
Je te cite : « Mais les constats sont là : pour des magazines spécialisés dans le disque classique, c’est la matière première qui, depuis une vingtaine d’années, vient à manquer. Les « majors » (Deutsche Grammophon, Decca, Warner, Sony) ont considérablement ralenti l’allure, les « nouveautés » se comptent sur les doigts des deux mains en année pleine. Ces nouveautés que les discophiles comme moi attendaient impatiemment de voir chroniquées dans leurs magazines favoris avant de se décider à acheter ou non, comparées avec les « références » précédentes. »
Il t’a echappé a l’évidence que depuis 40 ans la créativité discographique se passe chez les indépendants. Rester scotché sur une époque révolue, c’est une bonne partie du problème.

Yves Riesel ne fais pas semblant de ne pas m’avoir bien lu ! Evidemment que je sais et que je me réjouis de l’essor des éditeurs indépendants et des merveilles qu’ils publient ! Je voulais simplement relever que les « majors » ont cessé d’être des soutiens de la presse musicale (je me rappelle avoir entendu il y a longtemps de la part de la directrice marketing d’un célèbre magazine que l’attribution des récompenses dépendait du montant des pubs achetées par les éditeurs de disques et c’était avoué sans complexe !). Tu sais aussi bien que moi qu’aujourd’hui ce sont les artistes eux-mêmes qui financent leurs disques, que les éditeurs, petits ou grands, font le service minimum en terme de promotion.
Ces magazines étaient prescripteurs pour les apprentis discophiles que nous étions. Aujourd’hui 80 % des disques chroniques relèvent d’un répertoire de niche, qui intéresse évidemment les mélomanes curieux, mais qui n’attire pas un large lectorat.

Je n’ai pas pris pour moi le reproche de « rester scotché à une époque révolue », comme je pense l’avoir démontré depuis longtemps : https://jeanpierrerousseaublog.com/2015/09/29/le-grand-public/














