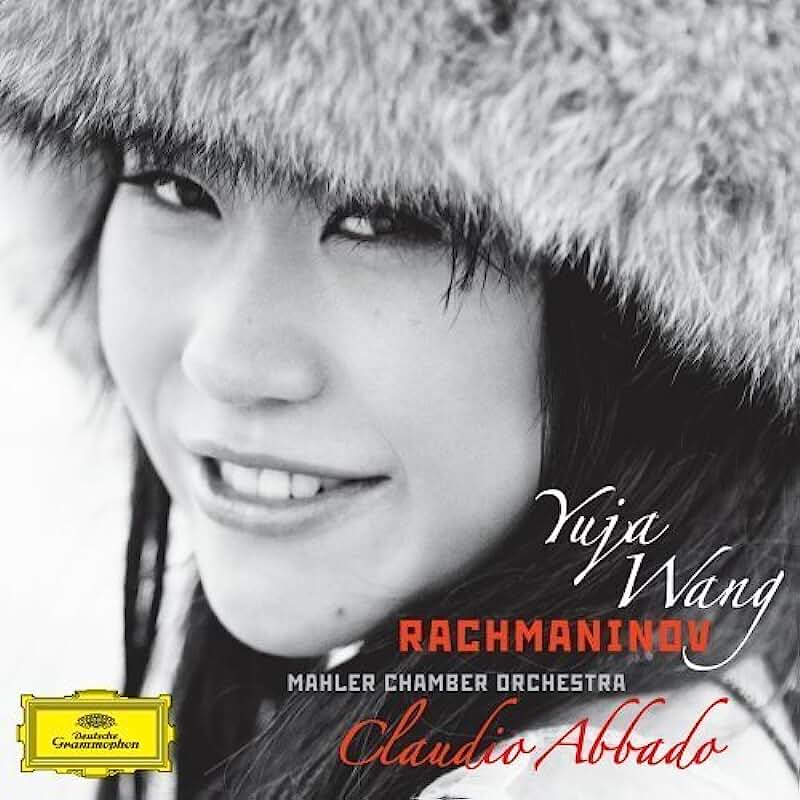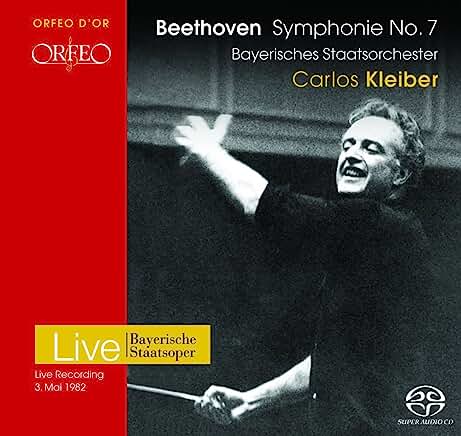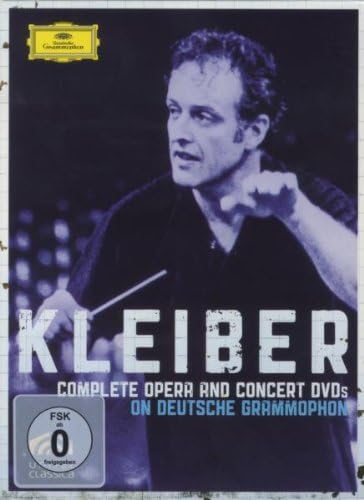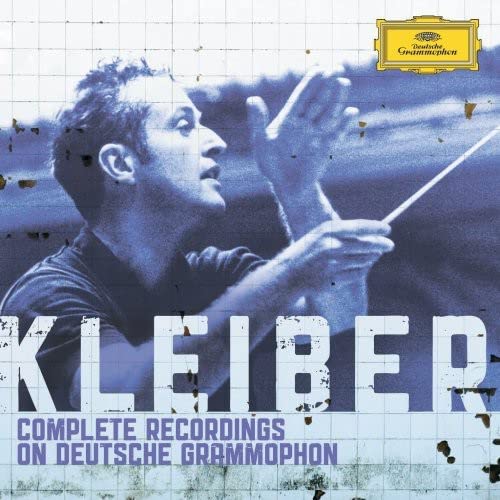Je ne compte plus les billets que j’ai consacrés à Leonard Bernstein (1918-1990), notamment une série d’été à l’occasion du centenaire de sa naissance en 2018 (Un été Bernstein).
J’ai eu deux occasions toutes récentes de réaffirmer mon admiration pour ce personnage hors norme : le film Maestro sorti avant-hier sur Netflix, et le magnifique concert donné par l’Orchestre philharmonique de Radio France ces jeudi et vendredi d’avant Noël, sous la direction de Robert Trevino.
J’ai écrit sur Bachtrack presque tout ce que j’en ai pensé : Le Noël américain du Philhar’.

Je veux souligner à nouveau l’originalité d’un programme qui, à part sa proximité temporelle, n’a que peu à voir avec Noël. C’était la première fois que j’entendais en concert l’un des sommets de l’oeuvre de Bernstein, les trop peu joués Chichester Psalms (1965), découverts par ce « live » de 1979

Je trouve sur YouTube une vidéo dont je n’arrive pas à identifier ni le lieu ni la date. C’est bien Leonard Bernstein qui dirige lui-même, apparemment en Pologne.
Bradley Bernstein
Je me méfie toujours des films de fiction sur de grands musiciens, de ce qu’on appelle des « biopics ». Il y a en général toujours des détails qui clochent, même quand le propos est réussi (comme dans le film Tar avec Cate Blanchett que j’ai beaucoup aimé : Mesures démesure).
Ici, Bradley Cooper est tout simplement bluffant, comme réalisateur et interprète de Bernstein. On a même un goût de trop peu, d’inachevé, quand s’achèvent les 2h9 de ce film et son très long générique – qui fait justement entendre le deuxième des Chichester Psalms. Le génie de Bernstein était tellement polymorphe, sa personnalité si multiple, qu’on est forcément frustré par la brièveté des scènes. Le film est centré sur des aspects moins connus, plus privés, du personnage, sa rencontre, son mariage, son amour pour Felicia Montalegre, disparue à 56 ans des suites d’un cancer, douze ans avant celui qui emportera Bernstein lui-même en 1990 (La cigarette est de quasiment tous les plans…), et les amitiés/amours masculines que le chef/compositeur vivait sans vraiment s’en cacher.
On redit ce qu’on a déjà écrit ici, la meilleure manière de découvrir, d’aimer et de faire aimer Léonard Bernstein à tous ceux qui comme moi n’ont jamais eu la chance de le voir sur scène, ce sont ses Young People Concerts, aujourd’hui heureusement facilement accessibles.

Et on retrouve avec un immense bonheur sur YouTube ce film réalisé trois ans après la mort de Bernstein :
Ce documentaire s’ouvre sur une déclaration, une proclamation même, de Bernstein qui n’avait plus que quelques mois à vivre : « J’aime deux choses : la musique et les gens. Je ne sais pas ce que je préfère mais je fais de la musique car j’aime les gens, travailler avec eux »