Je mesure chaque jour la chance que j’ai de faire partie de l’équipe de Bachtrack et de partager un peu de la passion qui anime ses fondateurs et ses responsables par pays, à commencer par le rédacteur en chef de l’édition française ! Bachtrack est une référence dans le paysage européen de la musique classique.
Bilans
Preuve en est le formidable bilan de l’année musicale 2024 dressé par le site, à partir évidemment de ses propres statistiques et observations. Bilan repris à son compte et commenté par Diapason !

J’invite à découvrir ce riche bilan, traduit de l’anglais et commenté in fine par Tristan Labouret :
Des chiffres et des notes : les statistiques Bachtrack 2024 de la musique classique
A propos de bilan, tout le monde s’accorde à dire que celui de Jean-Philippe Thiellay, président jusqu’au 31 janvier du Centre national de la Musique, est bon, voire très bon. Surtout quand on songe qu’il a été en première ligne lors de la période COVID ! J’en sais quelque chose, comme responsable d’un des grands festivals de musique à l’époque. S’il n’y avait pas eu quelques têtes bien faites comme lui (que j’avais connu quand il était directeur adjoint de l’Opéra de Paris) pour obtenir des décisions du ministère de la Culture qui nageait en plein brouillard (lire Même pas drôle), je ne sais pas ce que mes camarades d’Avignon, Aix, Orange ou La Roque d’Anthéron auraient pu sauver, sans parler de tous les autres festivals de France et de Navarre.
J’ignore pourquoi Thiellay n’a pas été reconduit. Il a dû déplaire. Il aura au moins la fierté du devoir accompli.
Dolly au Lido
Dans mon papier pour Bachtrack sur l’opéra de Haendel, Orlando, qui est actuellement donné au Châtelet, j’écrivais : « Depuis la période Lissner-Brossmann, on avait perdu l’habitude du lyrique, a fortiori du baroque, dans ce qui est redevenu le temple de la comédie musicale et de l’opérette. » C’est un constat, et sûrement pas un regret. J’ai ici même assez souvent cité et loué Jean-Luc Choplin qui, contre vents et tempêtes de la bien-pensance, avait ressuscité l’histoire des lieux, avec une provocation réjouissante – son premier spectacle était Le chanteur de Mexico !. Choplin est ensuite parti à Marigny, et lorsque le théâtre a changé de propriétaire, il est parti quelques centaines de mètres plus loin, redonner une nouvelle vie à un lieu mythique de la nuit parisienne, le Lido.
Jusqu’à hier soir, je n’avais jamais mis les pieds au Lido, le cabaret. Je me rappelle juste un magasin de disques qui le jouxtait, où les prix étaient plus élevés qu’ailleurs, mais on m’avait répondu une fois que l’adresse (les Champs-Elysées) se payait !

J’ai passé une excellente soirée, non sans avoir relevé – on n’oublie pas son passé professionnel – la qualité de l’accueil, des vigiles dans le couloir d’entrée ou dans la salle, à tout un personnel très paritaire, jeune, souriant et diligent. Seul bémol qu’on a déjà dû signaler maintes fois au maître des lieux : le sous-dimensionnement évident des toilettes !
Un bravo particulier aux excellents musiciens qu’on ne voit pas ici sur ce teaser mais qui sont bien placés en surplomb de la scène.
Rappel : je rappelle que j’ai, parallèlement à ce blog, une sorte de « diary », de journal où je consigne humeurs, réactions, séquences de vie : brevesdeblog
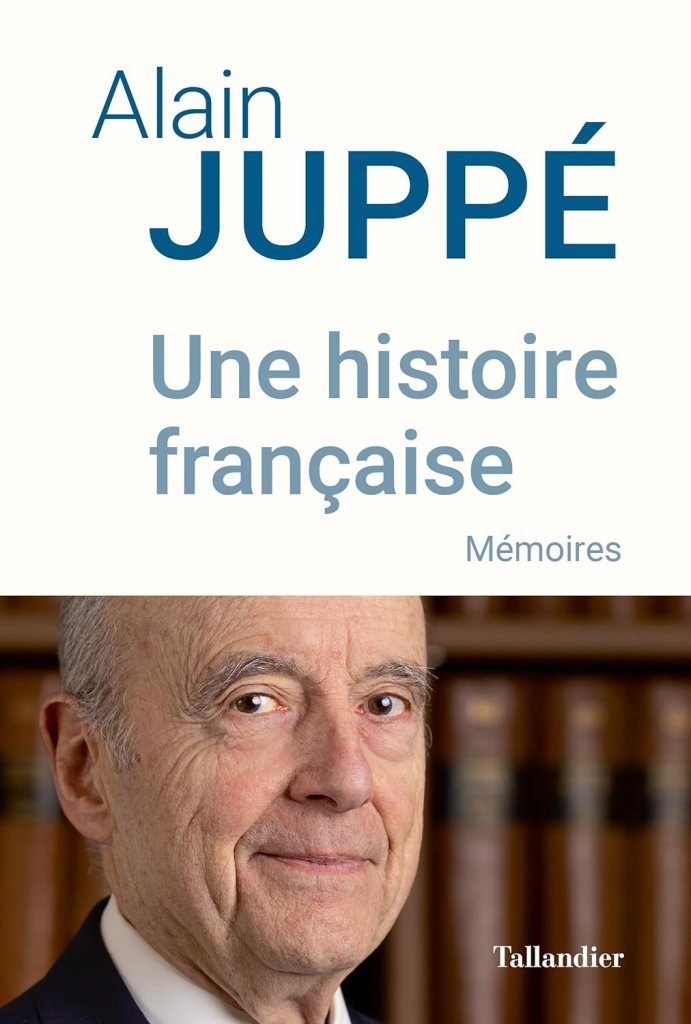



























 (
(