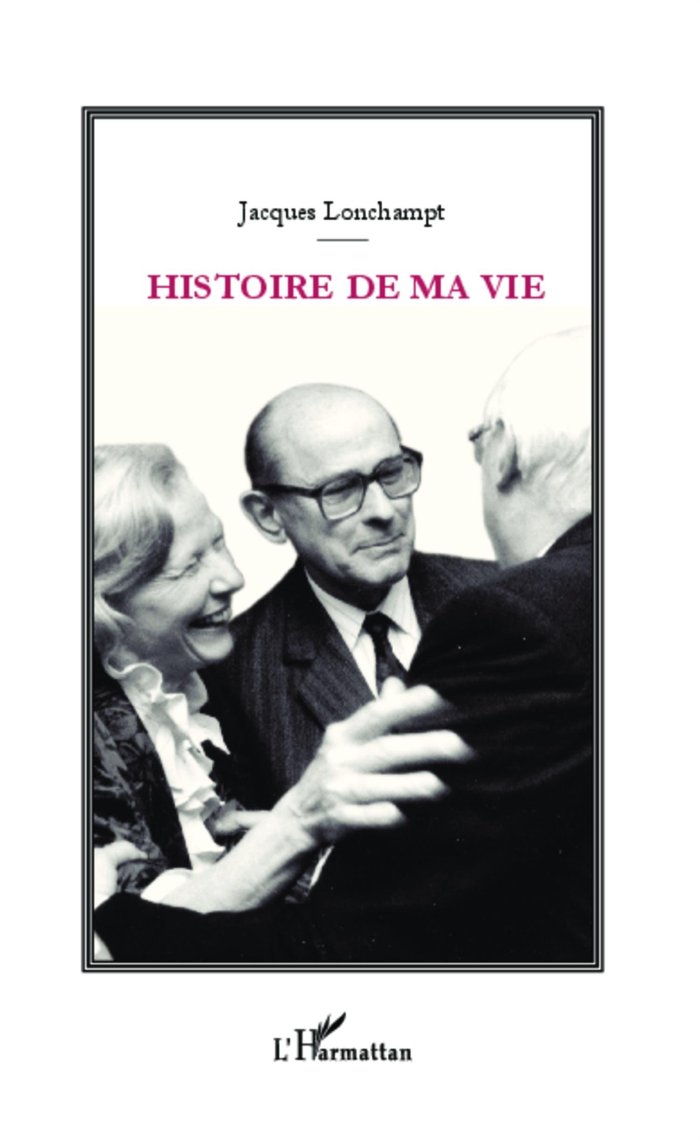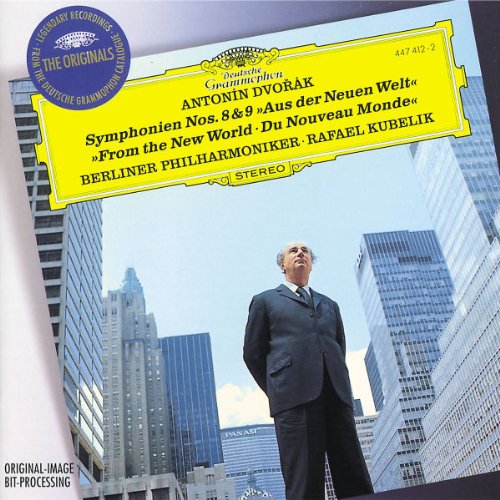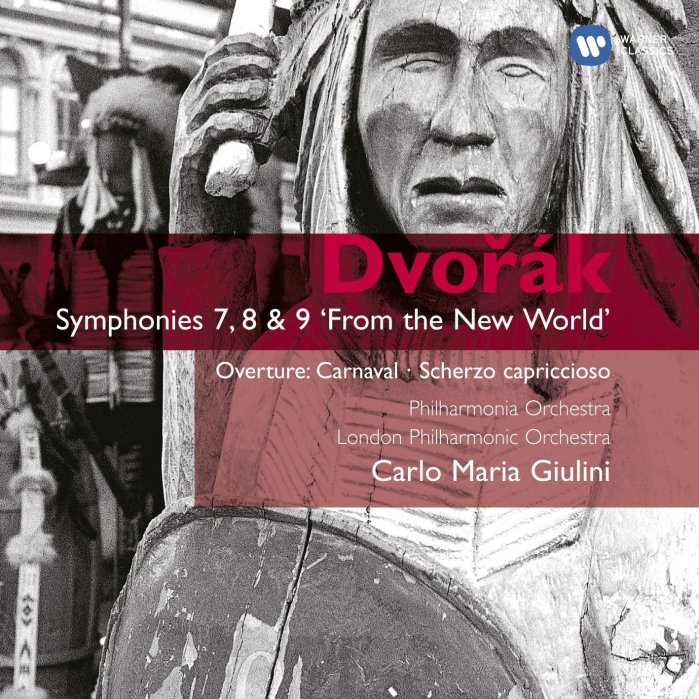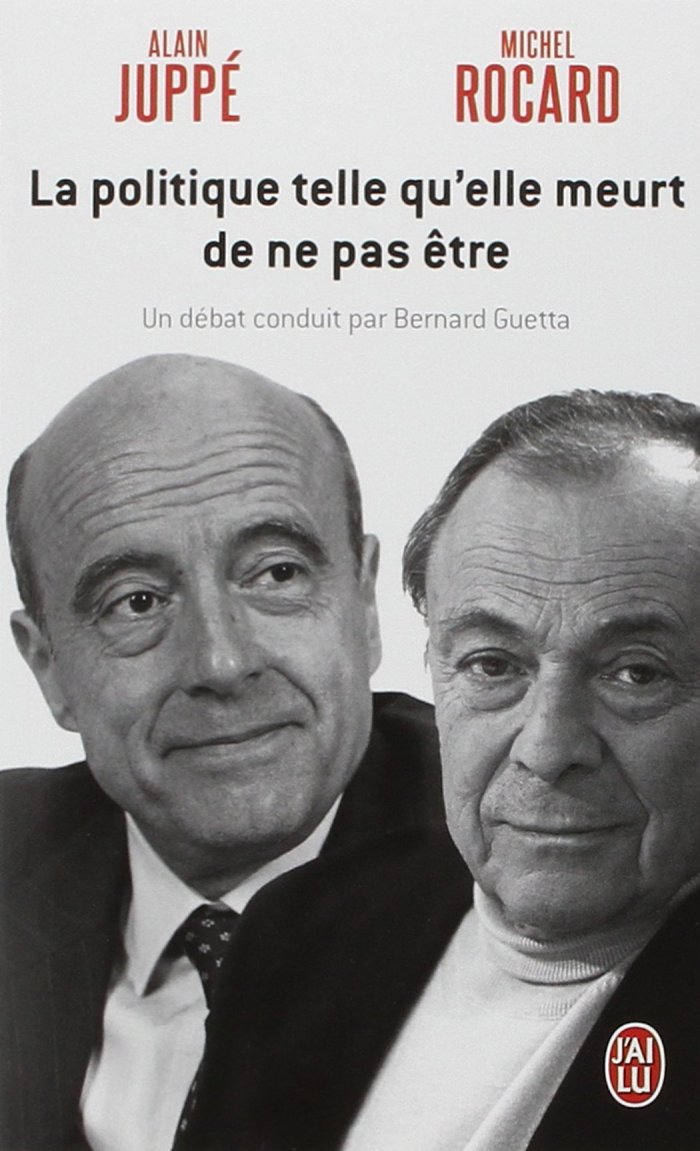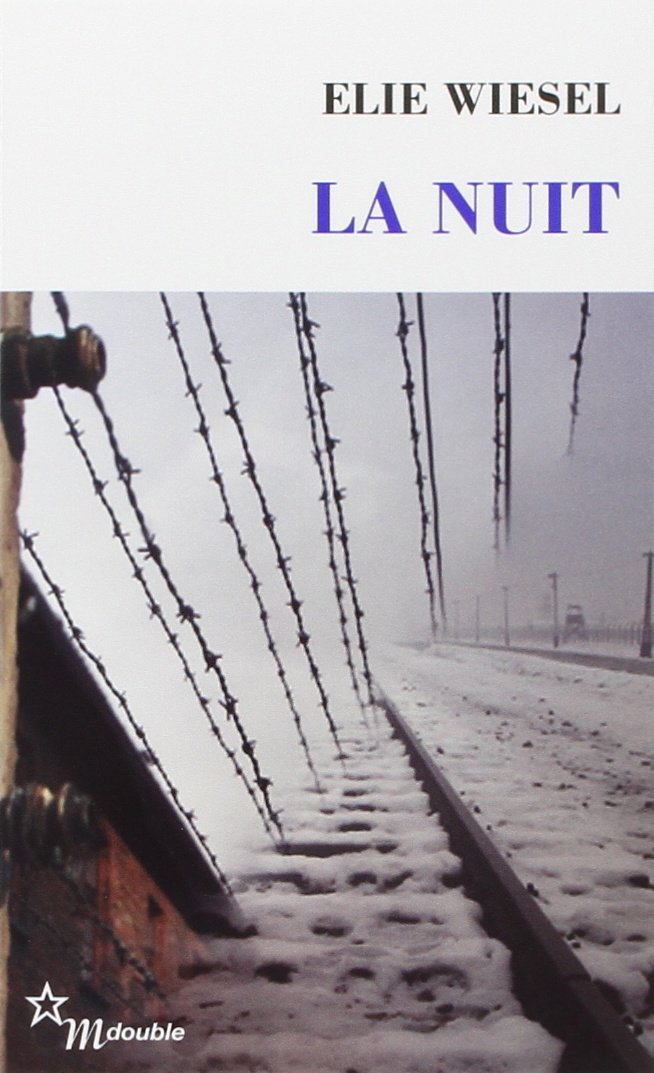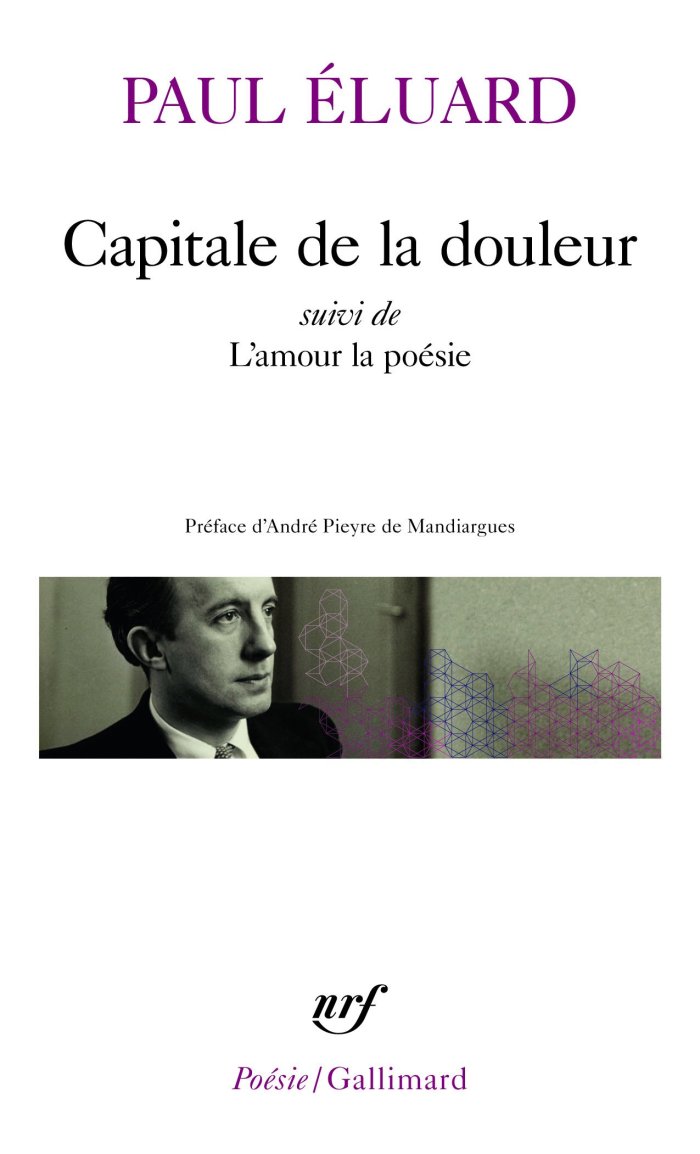C’est l’éternelle chanson de Charles Trenet qui nous vient aussitôt lorsqu’on apprend la disparition d’Yves Bonnefoy.

J’ai un souvenir qui ne m’a jamais quitté de la présence, de la voix, du regard d’Yves Bonnefoy. C’était à Thonon-les-Bains, il doit y avoir 25 ans, Michel Chaboud, l’excellent directeur de la Maison des Arts, avait prévu, pendant l’été, dans la cour carrée de la Visitation, des récitals de poésie qui eurent beaucoup de succès. Celui d’Yves Bonnefoy fut une révélation.
Extraits d’un discours prononcé par Bonnefoy le 22 septembre 2014 au Mexique, comme un précieux résumé de la vie et des amours du poète et un plaidoyer pour « la fondamentale nécessité de la poésie » :
…sur cette forme particulière de questionnement du monde et de l’existence que l’on appelle la poésie? Penser à celle-ci n’est plus aujourd’hui quelque chose de naturel et de simple. Je ne doute pas que la poésie soit encore très largement reconnue, aimée, pratiquée, dans votre pays et les autres de l’Amérique latine. Il y a encore dans votre société de langue espagnole ancrée dans un riche passé préhispanique cette belle continuité entre la culture populaire et les préoccupations de l’intellect qui est le lieu dans l’esprit où la poésie prend le plus vigoureusement sa source.
Je vois de grandes œuvres se succéder parmi vous et retenir une assez large attention. Mais ailleurs dans le monde le regard que la technologie et ses emplois commerciaux incitent à jeter sur la réalité naturelle et sociale n’est pas sans porter préjudice à la sensibilité poétique et à son intelligence de la vie. En France, par exemple, nos universités ont tendance à placer les sciences humaines et le débat des idées au premier plan de leurs intérêts, et c’est aux dépens de la poésie, dont on ne ressent plus assez la fondamentale nécessité. Il est donc bien que le prix que l’on m’accorde aujourd’hui mette l’accent sur cette nécessité…
Mais pourquoi est-il si nécessaire de penser à la poésie ? Est-ce parce qu’il y aurait en elle des aperçus sur la condition humaine plus nombreux ou plus importants que ceux que, par exemple, savent reconnaître les philosophies de l’existence ? Ou qui seraient formulés avec plus d’imagination ou d’éloquence que dans les écrits que l’on appellera de la prose ? Oui, certes, il est bien vrai que les grandes œuvres de la poésie – lesquelles ne sont pas seulement des poèmes, je place au premier plan parmi elles un Shakespeare ou un Cervantès – se risquent très avant dans les labyrinthes de la conscience de soi. C’est dans les hésitations angoissées d’Hamlet ou les rêveries généreuses de Don Quichotte que la modernité de l’esprit a trouvé son sol le plus fertile. Et il y a en chacun de nous un rapport à soi qui ne se défait jamais autant des illusions de l’existence ordinaire que quand nous entendons un rythme s’emparer des syllabes longues et brèves des mots de notre langue natale.
Et ce n’est pas, pour autant, qu’il ne faille pas se garder des enivrements faciles de la musique verbale. Le rythme dans les mots peut se mettre au service de simplement l’éloquence. Le mensonge peut s’en servir. Mais il n’en est pas moins un appel qui nous saisit très en profondeur, s’adressant à nos émotions, bousculant nos convictions paresseuses. Par ce renflammement de la parole nous recommençons d’exister, par sa voie peuvent reparaître, parmi assurément bien des leurres, des besoins et des intuitions qui sont notre vérité la plus essentielle. Car l’existence, cette vie humaine qui naît et qui doit mourir, qui est finitude, qui se heurte sans cesse aux imprévus du hasard, c’est, avant tout, un rapport au temps ; et comment accéder à l’intelligence du temps sinon en écoutant les rythmes, cette mémoire du temps, travailler sur les mots fondamentaux de la langue ?
Il y a ce rapport tout à fait spécifique et fondamental au temps dans la poésie, c’est ce qui fait d’elle l’approche la plus directe de la vérité de la vie. En français, par exemple, nous devons à Villon, à Racine, à Baudelaire, de percevoir des aspects de la condition humaine que nul davantage qu’eux n’a su reconnaître. Le rôle décisif du rapport à autrui dans l’éveil du moi, dans son intellection de ce qui est ou n’est pas, n’a jamais été plus intensément éprouvé que dans quelques poèmes des Fleurs du mal. Mais l’essentiel de la poésie n’est tout de même pas à ce niveau où la vérité de l’humain se dégage et se manifeste. Il est par en dessous, dans la vie même des mots, et c’est à cette profondeur dans la parole qu’il faut savoir rencontrer l’action de la poésie et, de ce fait, comprendre son importance. Comprendre qu’elle est le fondement de la vie en société. Comprendre que la société périra si la poésie s’éteint, peu à peu, dans notre rapport au monde.
L’essentiel de la poésie, ce rapport aux mots ? Oui, et maintenant je m’explique. Que sont les mots ? Est-ce ce qui permet de penser aux choses, d’en analyser la nature, d’en dégager des lois, d’énoncer celles-ci, en bref d’élaborer la connaissance du monde et d’organiser nos actions dans celui-ci ? Oui, les mots sont cela, nous les savons porteurs des concepts qui bâtissent pour nous ce que nous nommons la réalité, et qui nous l’expliquent,. Mais cette réalité que nous devons à la pensée conceptuelle est-elle vraiment, est-elle pleinement, ce qui existe hors de nous et aussi en nous, dans l’intimité de nos vies, n’en est-elle pas qu’une image aussi schématique que partielle, et peut-être même affectée d’un manque fondamental ? La pensée conceptuelle, c’est de la généralité, en effet, c’est de l’intemporel, elle ne peut donc pas percevoir en nous cette expérience du temps qui, je le disais, est notre être même. Les mots nous trahissent-ils ?
Mais écoutons certains d’entre eux, écoutons-les en eux-mêmes, sans faire effort de pensée. Prononçons le mot « arbre » ou le mot « fleuve », ou, avec Mallarmé, le mot « fleur », ou ces autres mots qui évoquent des êtres et non des choses, et que nous appelons les noms propres. Que vois-je quand je dis « arbre » ou « fleuve » ? Nullement la figure précisément définie que propose le dictionnaire. Je pense à l’arbre comme il existe, avec toutes ses branches, toutes ses feuilles, mais aussi son implantation au bord d’un chemin, sa place possible dans ma vie. Et cette idée que j’en ai est évidemment imprécise, mais ce que je sais, en tout cas, ce que je ressens au plus profond de moi-même, c’est que cet arbre, quelque il puisse être, est dans un lieu où je puis moi-même marcher, il est comme moi, comme chacun de nous, la proie du temps qui fait naître et qui fait mourir…
J’ai longtemps fréquenté, lu et relu, quelques poètes découverts, pour la plupart, grâce à d’intelligents professeurs de français au lycée. Avec une préférence pour les Parnassiens, Baudelaire, Prévert, Éluard…
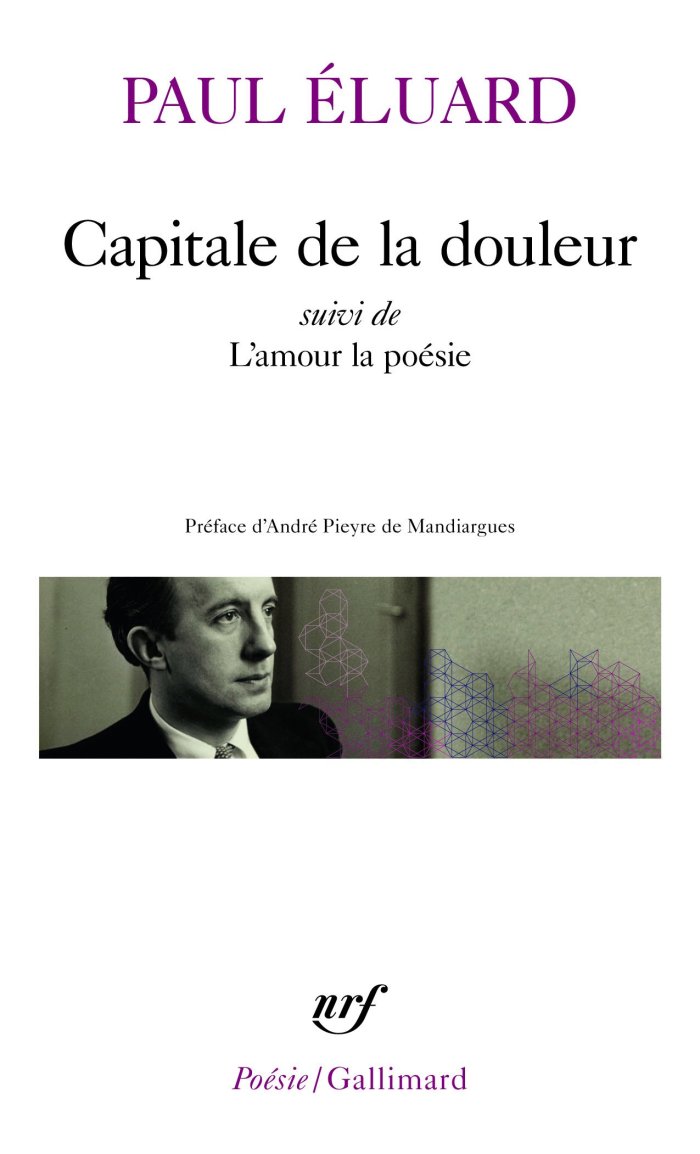
J’ai compris plus tard pourquoi j’aimais tant les oeuvres vocales, les cycles de mélodies, de Lieder, des compositeurs français certes (Debussy, Poulenc, Fauré sans oublier Britten et ses Illuminations rimbaldiennes) mais évidemment tout ce qui est écrit en allemand ou en russe, mes langues de prédilection. On a l’embarras du choix…