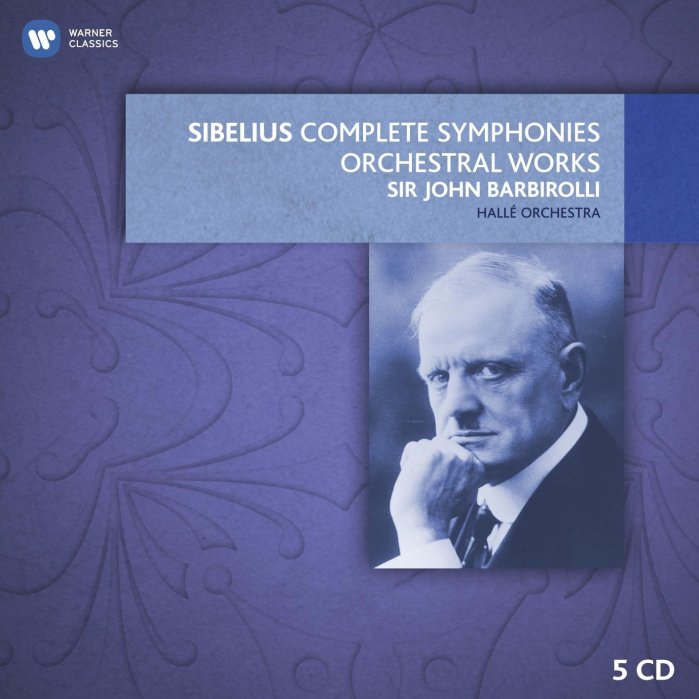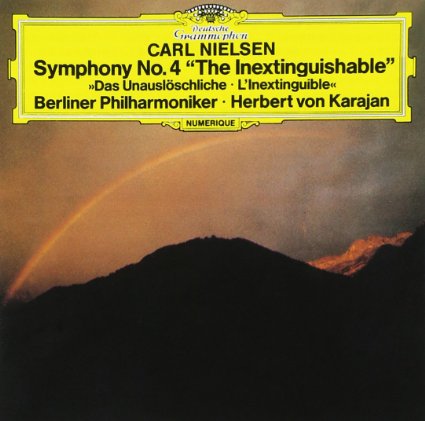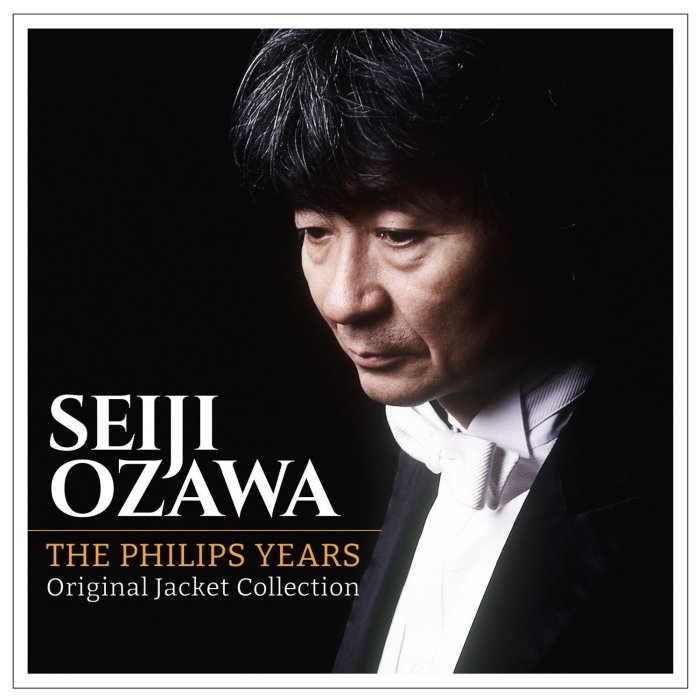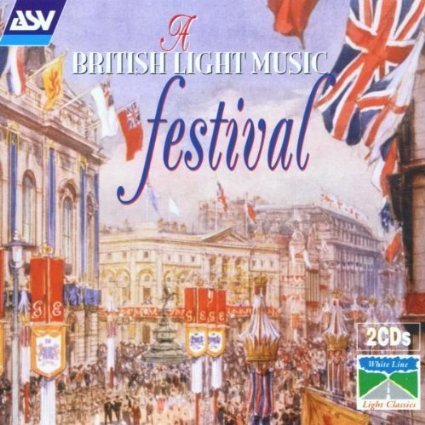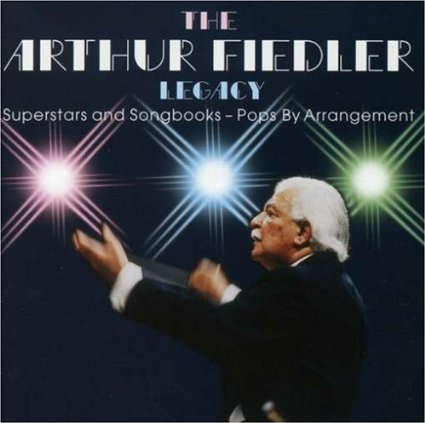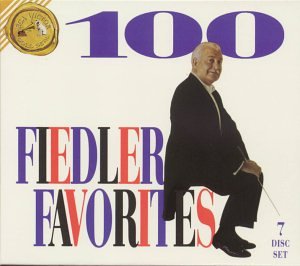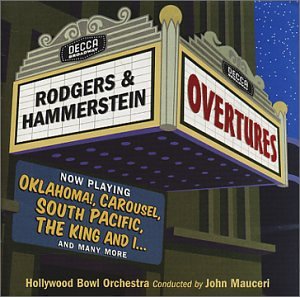On n’imagine pas comme ça, vu du dehors, mais le petit monde de la musique classique est plein de chausse-trapes. Comme le relève Gaëtan Naulleau dans le numéro de novembre de Diapason, la guerre fait rage entre Deutsche Grammophon-Decca / Universal et Sony : la première s’est fait piquer par le second deux de ses stars, Jonas Kaufmann et Lang Lang. Au moment où le pianiste chinois sort son dernier album (on y reviendra, pour la belle arnaque sur le titre : Lang Lang in Paris ) chez Sony, Deutsche Grammophon ressort – objet de l’ire diapasonesque – une compilation très hétéroclite du même sous le titre Lang Lang the Vienna Album !
Un mot sur le titre du CD Sony : le lien entre Paris et les Scherzos de Chopin ou les Saisons de Tchaikovski ? Aucun ! Tromperie sur la marchandise ? Pas tout à fait puisque ce disque a bien été enregistré… à Paris (à l’Opéra Bastille précise-t-on même !). La belle affaire… ou plutôt la bonne affaire pour l’image internationale de LL.
La guerre Sony/Universal avait commencé il y a quelques semaines, dans le même genre :
Decca avait dégainé le premier avec un album/compilation au titre encore une fois trompeur (The Age of Puccini), sachant que Jonas Kaufmann allait sortir un CD tout Puccini chez Sony. Il a fallu que le chanteur lui-même dénonce le procédé…
Pas très reluisant évidemment, mais il n’y a pas mort d’homme…et puis on est loin, très loin des montants engagés pour des transferts de stars du ballon rond !
Plus désagréables pour les auditeurs/consommateurs de musique que nous sommes, les petites arnaques qui non seulement trompent l’acheteur mais desservent les artistes qui en sont aussi victimes. En cause, les enregistrements « libres de droits », en gros ceux qui ont plus de 50 ans (beaucoup d’exceptions évidemment). Sur les sites de téléchargement (comme Itunes) on est envahi de repiquages, de mauvaises copies de microsillons, absolument épouvantables, à petit prix évidemment, avec parfois de très bonnes surprises (Monteux, Richter, Heifetz…) mais à condition de bien écouter d’abord avant de télécharger.
On est effaré par exemple par la désinvolture – pour rester poli – avec laquelle un établissement aussi prestigieux que la Bibliothèque Nationale de France réédite numériquement quantité d’enregistrements relevant du dépôt légal. Aucun travail éditorial, ni technique, sérieux. Des erreurs en pagaille sur les oeuvres, les interprètes, les compositeurs. Incompréhensible, inadmissible.
Même saccage dans certaines rééditions de CD. Depuis longtemps fan des symphonies de Beethoven gravées par René Leibowitz à Londres en 1959/1960 dans une prise de son stéréo de référence, publiées séparément sous diverses étiquettes (comme Chesky Records) je me suis réjoui de les voir enfin proposées dans un coffret que j’ai aussitôt acheté. Quelle déconvenue en mettant sur ma platine quelques plages au hasard ! Une catastrophe, un report complètement raté. Une honte !
La même horreur existe, en pire, sur Itunes, si on n’y prend pas garde.
Autre arnaque, heureusement pas encore trop répandue, les rééditions « avec pochettes d’origine » de grands artistes du passé. Quand les minutages des microsillons d’origine étaient brefs, ça peut donner des CD très chiches.
On atteint parfois les limites du ridicule. Déjà le coffret des enregistrements de Jean Martinon avec l’orchestre symphonique de Chicago – que tous les amateurs attendaient avec impatience – aurait pu tenir en 5 CD au lieu des 10 qu’il contient.
Mais le pompon est décroché par cette sortie toute récente : Earl Wild, the RCA complete collection.
On salivait à la perspective de redécouvrir des enregistrements forcément légendaires du grand virtuose américain qui n’était pas loin de fêter son centenaire sur scène (il est mort à 95 ans, en 2010, encore en activité). 5 CD (pour 40 € le coffret), qui tenaient sans problème sur…2 galettes ! Un Gershwin multi-réédité (ici coupé en deux !), certes deux ou trois raretés (le concerto de Paderewski, le 1er concerto de Scharwenka, et quelques babioles qui font très fond de tiroir). Il y a tellement de bons enregistrements, certes éparpillés entre plusieurs labels, à rééditer pour le centenaire du pianiste…qu’on se serait bien passé de ce triste boitier. Par exemple la plus éblouissante des intégrales concertantes de Rachmaninov, ou quand pianiste et chef sont à l’unisson de l’esprit et du style du compositeur.