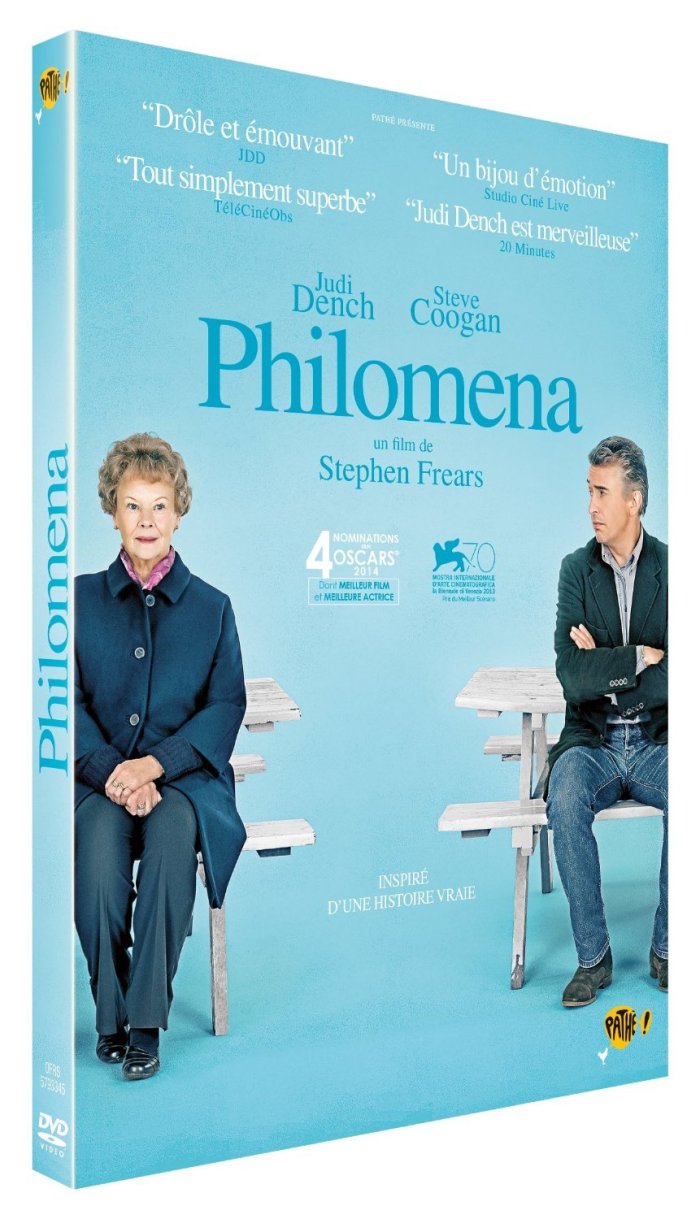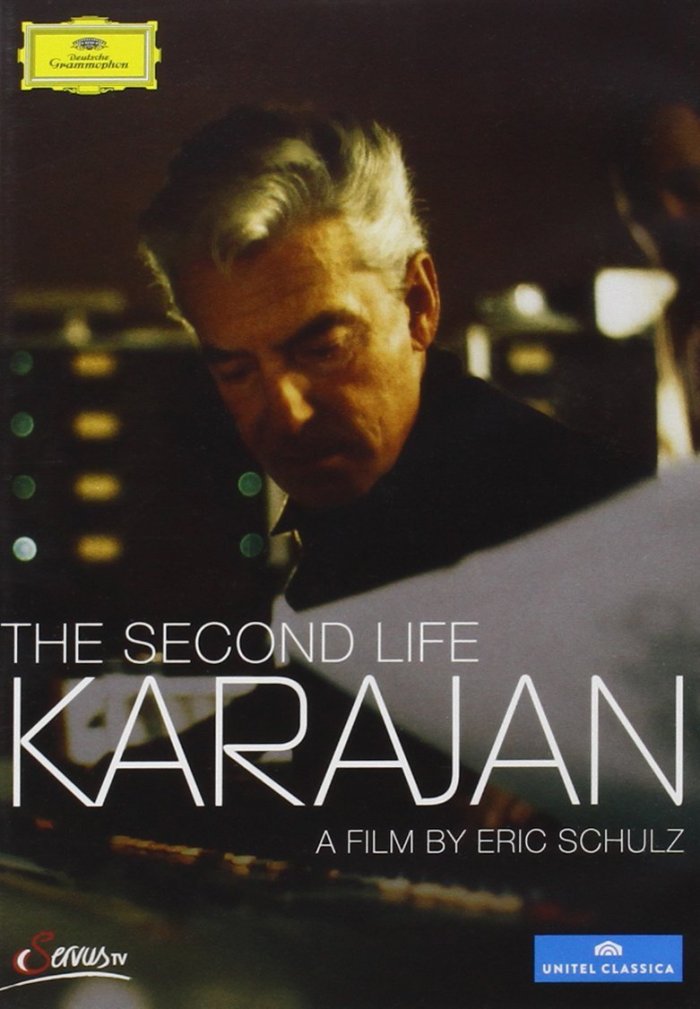A l’heure où j’écris ce billet, l’Orchestre philharmonique de Berlin n’a toujours pas de chef pour succéder à Simon Rattle en 2018. La grande affaire de ce lundi 11 mai était le « conclave » qui réunissait dans une église de Dahlem les 124 musiciens qui ont le droit de voter pour leur chef. Pas de fumée blanche à l’issue de plusieurs heures de réunion, et de plusieurs votes on l’imagine.
Déjà lors des précédents épisodes de ce type, à la mort de Karajan, puis pour la succession d’Abbado, l’unanimité avait été loin d’être atteinte. Ni Claudio Abbado, après Karajan, ni Simon Rattle après Abbado n’avaient été choisis facilement. On se rappelle les blessures (d’amour-propre) de Maazel ou Barenboim qui s’y étaient préparés…en vain !
Les médias s’emparent de l’affaire comme s’il s’agissait de l’élection d’un pape ! On va même jusqu’à écrire que l’orchestre se retrouve sans chef…
Peut-on avancer deux ou trois réflexions politiquement pas très correctes ?
Un peu d’histoire d’abord.
Si Ansermet avec l’Orchestre de la Suisse Romande, Mravinski avec l’Orchestre philharmonique de Leningrad, Ormandy avec l’Orchestre de Philadelphie, ont laissé une trace cinquantenaire, si Karajan (élu « chef à vie ») s’est voué à Berlin pendant 34 ans (1955-1989), comme Zubin Mehta à Tel Aviv avec l’Orchestre philharmonique d’Israel depuis 1981, si James Levine est le patron du Metropolitan Opera de New York depuis 42 ans, si Ozawa a dirigé le Boston Symphony de 1973 à 2002, si Bernard Haitink a tenu les rênes du Concertgebouw d’Amsterdam pendant un quart de siècle, l’ère de ces longs règnes paraît bien révolue.
À Berlin justement, Claudio Abbado aura fait 13 ans (1989-2002), Simon Rattle 16 ans (2002-2018), l’un et l’autre auront connu autant de succès que de revers.
On dit à juste titre que Berlin est l’un des meilleurs orchestres du monde, mais cette qualité tient-elle à la personnalité qui le dirige ? Au risque de choquer, je réponds par la négative. La qualité d’un orchestre tient d’abord à son mode de recrutement, à son organisation, à l’exigence du groupe : la meilleure preuve en est le Philharmonique de Vienne, qui n’a pas de chef titulaire, et qui assure jalousement la formation, le recrutement et la carrière de ses musiciens ! Certes un grand chef impose une personnalité, un son, une identité à « son » orchestre surtout si le compagnonnage est d’une certaine durée.
Reprenons l’exemple de Berlin : on a longtemps loué (ou critiqué) le Karajan sound, ce fameux legato, cette somptuosité, cette onctuosité des cordes, et pour avoir eu la chance d’assister à quelques concerts « live », je peux témoigner qu’en concert on entendait vraiment l’orchestre comme au disque. Mais qu’on prenne d’autres enregistrements réalisés avec l’orchestre pendant l’ère Karajan, on n’entend pas le même son avec Böhm, Cluytens (l’intégrale des symphonies de Beethoven au début des années 60), Kubelik ou Maazel. Finalement tout ce que certains ont reproché à Abbado ou Rattle – ils avaient abîmé, voire perdu ce fameux « son » berlinois ! –



Chef permanent ou directeur musical ?
Les exemples cités plus haut sont ceux de patrons incontestés des phalanges qu’ils animaient, l’expression « chef permanent » avait tout son sens, même si ces grands chefs ne refusaient pas quelques invitations prestigieuses en dehors de leurs orchestres. Il y a belle lurette que l’expression est obsolète, et qu’on parle aujourd’hui de « directeur musical« .
Pourquoi cette évolution ? D’abord parce que plus aucun grand chef n’accepterait de se lier exclusivement à un orchestre… et qu’aucun orchestre ne supporterait plus de se retrouver semaine après semaine avec le même chef. Un directeur musical consacre en général de huit à douze semaines à « son » orchestre, indépendamment des disques et des tournées. Il ne cumule pas ou plus obligatoirement cette fonction avec celle de directeur artistique, autrement dit il n’est pas toujours l’unique responsable de la ligne artistique de l’orchestre.
Mais on continue à attribuer au chef/directeur musical un rôle, un pouvoir, une influence, qui ne correspondent plus à la réalité. Un orchestre vit, fonctionne, progresse grâce d’abord à la qualité de ses musiciens, à l’esprit collectif qui les anime, et bien sûr avec un management solide et compétent, sans lequel aucun chef, aussi prestigieux soit-il, ne peut exercer son art.
Il y a d’ailleurs un paradoxe étonnant : dans le domaine de l’opéra, on cite toujours l’intendant, le directeur, quand on évoque la Scala, le Met, l’Opéra de Paris (on parle de Rolf Liebermann, Hugues Gall, Gérard Mortier ou Stéphane Lissner), beaucoup plus rarement du directeur musical (même si, dans le cas de Paris, la personnalité de Philippe Jordan est incontestable). Dans le cas des orchestres, c’est le contraire, comme si rien n’avait changé depuis le milieu du XXème siècle !
Faut-il un directeur musical ?
L’impasse dans laquelle se trouvent les Berliner Philharmoniker, qui ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur un profil incontestable pour succéder à Simon Rattle, est finalement assez significative.
Qu’attend-on aujourd’hui d’un directeur musical ? Le prestige lié à une star de la baguette, mais y a-t-il encore des stars de la baguette, comme l’étaient des Karajan, Maazel et même Abbado ? Les noms qu’on cite encore ont tous dépassé largement la septantaine (Barenboim, Jansons, Muti, Haitink..). Le renouveau, le dynamisme de la jeunesse, mais au risque de l’inexpérience, et d’une déception rapide ? Certes, la génération montante ne manque pas de grands talents (les Nézet-Séguin, Bringuier, Nelsons, Dudamel, Afkham, Heras Casado, Denève, Petrenko (les deux, Kirill et Vassily), liste non exhaustive) qui sont sollicités partout, par tous les orchestres, au risque de n’avoir pas le temps de creuser leur sillon et de se forger une personnalité. Et la question qui fâche : quand l’une de ces jeunes baguettes arrive devant une phalange comme Berlin, qui dirige vraiment ? Le chef… ou l’orchestre ?
Pour répondre à la question posée en tête de ce paragraphe, je ne pense pas que des formations comme Berlin aient aujourd’hui réellement besoin d’un « directeur musical ». Pourquoi pas un nombre restreint d’invités privilégiés, qui couvrent de vastes répertoires et permettent des approches différentes. Ceux qui en pincent pour Thielemann et une certaine « tradition » germanique comme ceux qui ont apprécié les aventures de Rattle en terrain baroque, ceux qui aiment l’enthousiasme communicatif de Dudamel ou le panache de Nelsons y trouveraient tous leur compte.
Mais la question ne se limite pas à Berlin évidemment. Elle est pendante en France, à l’Orchestre de Paris (que Paavo Järvi quitte l’an prochain) où l’annonce d’un successeur se fait toujours attendre, ou à l’Orchestre National de France, où une réflexion a été entamée sans précipitation (et indépendamment des soubresauts de ces dernières semaines). Une chose est certaine pour ce dernier, il ne manque pas de très bons chefs, français notamment, pour le diriger, et l’histoire octogénaire de l’orchestre nous rappelle qu’on doit ses grandes et riches heures à des chefs… qui n’avaient ni le titre ni la responsabilité de directeur musical (Munch, Celibidache, Bernstein, Muti, même Maazel ne fut longtemps que « premier chef invité »), comme en témoigne l’indispensable coffret édité par Radio France et l’INA.

 (Helium Brass à Perpignan le 12 juillet)
(Helium Brass à Perpignan le 12 juillet) (Les breakdancers de Star Cross’d Lovers de David Chalmin le 14 juillet)
(Les breakdancers de Star Cross’d Lovers de David Chalmin le 14 juillet) (The Amazing Keystone Big Band le 17 juillet au Domaine d’O)
(The Amazing Keystone Big Band le 17 juillet au Domaine d’O) (Avec Paul Daniel le 20 juillet)
(Avec Paul Daniel le 20 juillet) (Lucilla Galeazzi chante Naples le 22 juillet)
(Lucilla Galeazzi chante Naples le 22 juillet) (Le Trio Karénine le 22 juillet à Aigues-Mortes, et dès le dernier accord du trio op.63 de Schumann un rideau de pluie)
(Le Trio Karénine le 22 juillet à Aigues-Mortes, et dès le dernier accord du trio op.63 de Schumann un rideau de pluie)
 (François-Frédéric Guy impérial dans Beethoven le 23 juillet)
(François-Frédéric Guy impérial dans Beethoven le 23 juillet) (Résurrection de La Jacquerie de Lalo et Coquard avec une troupe de choc : Michel Tranchant chef de choeur, Nora Gubisch, Véronique Gens, Patrick Davin, Charles Castronovo, Boris PInkhasovitch, Jean-Sébastien Bou, Patrick Bolleire et Enguerrand de Hys le 24 juillet)
(Résurrection de La Jacquerie de Lalo et Coquard avec une troupe de choc : Michel Tranchant chef de choeur, Nora Gubisch, Véronique Gens, Patrick Davin, Charles Castronovo, Boris PInkhasovitch, Jean-Sébastien Bou, Patrick Bolleire et Enguerrand de Hys le 24 juillet)





















 (©Guillaume Decalf / France Musique)
(©Guillaume Decalf / France Musique)