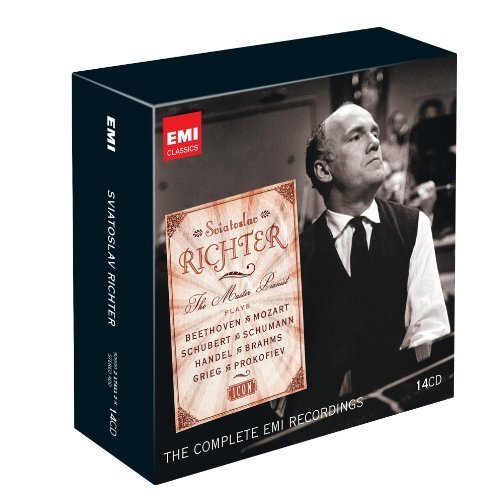(De gauche à droite, François Hudry, JPR en cravate (!), Chiara Banchini, Michel Corboz, Pierre Gorjat)
(De gauche à droite, François Hudry, JPR en cravate (!), Chiara Banchini, Michel Corboz, Pierre Gorjat)
Il y a trente ans, le 22 décembre 1987, la Radio suisse romande, sa chaîne culturelle et musicale Espace 2, lançait une émission de critique comparée de disques, sur le modèle de la défunte Tribune des critiques de disques de France Musique version Panigel, Bourgeois et Goléa. Pierre-Yves Tribolet, alors responsable musical de la chaîne, en avait confié la mission à François Hudry et m’avait demandé, sans que je puisse refuser (!), de former avec François et Pierre Gorjat le trio obligato qui serait le pilier de la nouvelle émission, Disques en Lice, toujours vivante trente ans après !
François Hudry tenait à innover par rapport au modèle : l’écoute des différentes versions se ferait à l’aveugle, et pour préparer l’émission, il nous avait réunis deux ou trois fois, dans son appartement proche du Victoria Hall de Genève, pour qu’évidemment nous apprenions, Pierre, lui et moi, à mieux nous connaître mais surtout pour tester avec nous ce principe de l’écoute anonyme. Que de surprises et de fous rires, de prises de bec parfois, nous allions vivre au fil des ans !
Parmi cent souvenirs, trois me reviennent : une émission sur Pelléas et Mélisande de Debussy avec autour de la table Hugues Cuénod, Jacques jansen et Irène Joachim, les partenaires de la légendaire version Désormière, une autre où nous comparions des versions de la Symphonie de Franck et où j’affirmai avec certitude entendre une sonorité typique d’orchestre américain – c’était Plasson avec son orchestre du Capitole ! -, ou encore la présence – il était assis à côté de moi – du mythique Armand Panigel pour une confrontation sur le 2ème concerto pour piano de Brahms.
Où je m’aperçus que le créateur de La Tribune était devenu nettement moins admirable à mes yeux : à vrai dire il redoutait l’exercice de l’écoute à l’aveugle, et ne voulant pas tomber de son piédestal, il pérorait volontiers tandis que nous écoutions les versions en lice. Tel pianiste était évidemment reconnaissable, « un Américain de toute évidence »…Je lui glissai qu’à mon avis nous écoutions Richter, je vis dans son regard qu’il me prenait pour un amateur. Lorsque François Hudry lui donna la parole, en premier évidemment, il affirma, de sa voix inimitable, que « bien sûr, il avait tout de suite reconnu la patte d’un célèbre pianiste….russe ». Mes voisins de table d’écoute furent estomaqués par tant de clairvoyance, jusqu’à ce que je leur raconte le fin mot de l’histoire.
Mais revenons à cette première émission de Disques en Lice en décembre 1987. J’étais non seulement intimidé par la présence de deux célébrités du répertoire baroque, mais je me sentais surtout totalement hors sujet : à la différence de mes compères François et Pierre, je ne m’étais jamais exercé à la critique musicale, et j’avais une connaissance très limitée de pans entiers du répertoire, comme cet Oratorio de Noël de Bach, opportunément choisi pour la circonstance.
L’émission n’était heureusement pas en direct, je me disais que si je proférais de grosses bêtises, elles pourraient toujours être éliminées au montage. Mais je n’en menais pas large, même si François Hudry m’avait justement conseillé de rester naturel, de me mettre à la place de l’auditeur et de ne pas poser au spécialiste. C’est finalement la ligne de conduite que je garderai tout au long de ma présence dans l’émission (que je devrai quitter en juillet 1993, pour cause de départ de la RSR… et de nomination à la direction de France Musique). Je m’apercevrai finalement que dire parfois tout haut ou poser les questions que l’auditeur n’ose jamais poser de peur de passer pour un ignorant, me permettait souvent plus de pertinence et d’impertinence dans mon propos et un éclairage moins « codé » sur l’oeuvre écoutée. Malgré cela, je ne doute pas d’être plus d’une fois passé pour un cuistre.
Et puis, comme je l’écrivais récemment (C’était mieux avant ?), je ne me suis, au fond, jamais senti l’âme d’un critique, qui est un genre en soi. Je suis trop impliqué, depuis trente ans justement, dans la vie musicale, dans la proximité des musiciens, pour être à l’aise dans un exercice qui suppose de la distance. Critique je le suis tous les jours dans mon métier, tant vis-à-vis de moi que des artistes que je fréquente ou engage, mais je connais trop les servitudes de leur noble métier, les contraintes de leur art, les conditions parfois rocambolesques d’un enregistrement, pour me poser en juge. Je préfère exprimer, ici ou ailleurs, mes enthousiasmes et taire mes déceptions.
Je ne me rappelle plus quelle version de l’Oratorio de Noël nous avions choisie. Peut-être l’une de ces deux-là qui m’accompagnent depuis longtemps :
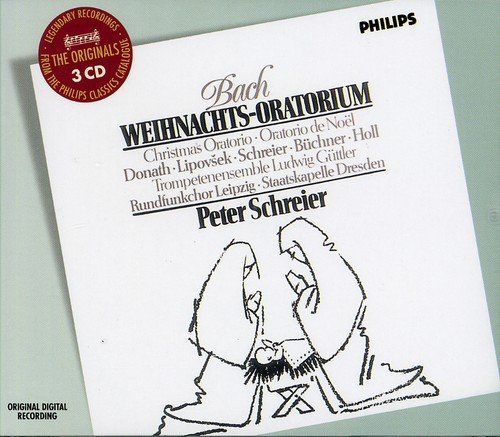

Une demande à Warner Classics : ne serait-il pas temps de rééditer l’extraordinaire discographie de Michel Corboz, qui, pour n’avoir pas eu l’aura ou le prestige de ses confrères Harnoncourt, Gardiner ou Herreweghe a considérablement oeuvré à la redécouverte d’un immense répertoire choral, de Monteverdi à Frank Martin.